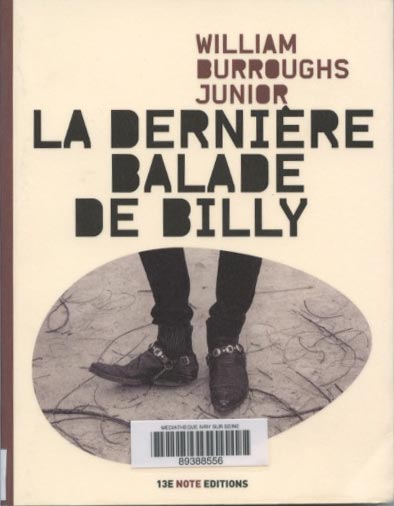Prix du livre France Inter, c’est un drôle de bouquin tramé par une drôle d’auteure, Olivia Rosenthal, qui aime se documenter pour raconter ses fictions. Pour ce livre, dont le titre le rend plus léger qu’il n’est, elle voulait d’abord parler des animaux, car tout le monde aime les animaux. Puis, en structurant son récit, elle a compris qu’elle devait aller là où sont traités les animaux : labos, boucheries, élevages en batterie ou non, abattoirs. Donc il s’agit aussi de l’interaction entre l’homme et l’animal en même temps que de la similitude entre élevage et éducation. Le récit principal est celui d’une enfant qui rêve d’un animal vivant à la maison mais qu’elle n’aura jamais. Ou alors un animal dont elle ne rêve pas, un canari, échappant au pire : le poisson. On pense qu’elle voulait un mammifère. Puis cette enfant grandit et renonce à des tas de choses, face à ses parents qui ne la comprennent pas, pas plus que le reste de la société, les étudiants, son mari, ses collègues, qui l’obligeront à composer avec ces données pour pouvoir s’en sortir. Comme les animaux de laboratoire ou d’élevage qui peuvent trouver quelque part un certain confort à vivre ce qu’on leur inflige, car, si l’on en croit l’auteure, leur pauvre vie s’y déroule dans les meilleures conditions possible concernant leur bien-être.
Ce livre passionnant est plus compliqué à expliquer qu’à lire car il se compose de courts paragraphes alternant sur les lois éthiques, les aménagements, l’imprégnation, la dépendance etc, dans un style très clinique. Il fait aussi référence à quelques films fondateurs pour l’héroïne tels King-Kong, Rosemary’baby et surtout la féline de Tourneur où elle attend la métamorphose de la femme en animal dangereux, ou libre, comme elle-même attend la sienne.
Pour en savoir plus sur sa démarche, lisez son interview ici.
Edition Verticales 2010.
Texte © dominique cozette