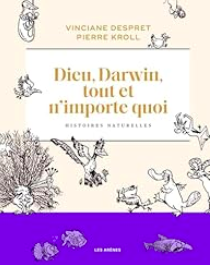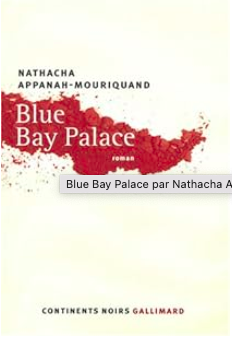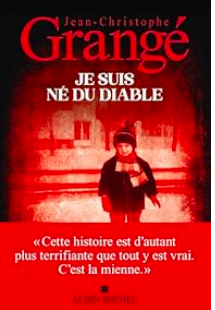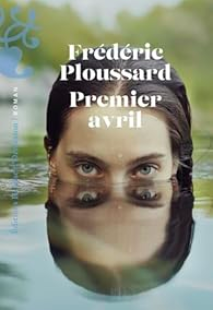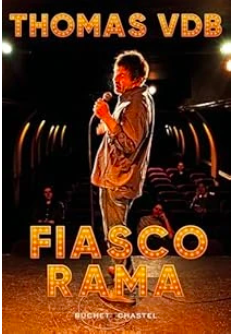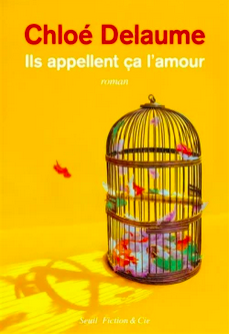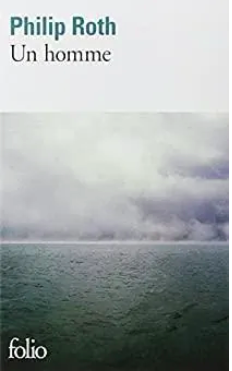Son premier livre Nos 14 novembre publié en 2016 a raconté le drame : le mari d’Aurélie Silvestre a été assassiné au Bataclan, elle était enceinte et ils avaient un petit garçon. Ce deuxième opus Déplier le cœur relate toute la période du procès des attentats auquel elle va assister comme partie civile qui débute en septembre 2021 et se tient jusqu’en juin 2022. Elle n’attend pas du verdict autre chose que de tenter de clore ce douloureux épisode de sa vie et de celle de ses petits, elle sait qu’on ne surmonte pas un tel traumatisme, mais au moins toute cette histoire sera derrière elle.
Car même si elle est très entourée, ses proches finissent par lui reprocher tacitement son état de victime, comme si elle n’avait qu’à oublier pour vivre comme tout le monde.
Le procès lui inflige à nouveau de terrible épreuves, celle notamment de côtoyer les assassins de son mari, la fatigue que procure l’e fait l’obligation de « redevenir normale » quand elle rentre à la maison après des séances éprouvantes, face à son nouvel amoureux qui n’a pas toujours la force de porter ce drame avec elle.
Sa réflexion très intime sur sa reconstruction de femme, son désir de s’amuser, de faire la fête malgré tout, elle sait les raconter tantôt de façon cash tantôt avec force nuances. Ainsi, elle noue des relations très fortes et des amitiés durables avec certains protagonistes du procès qui sont sûrement les seuls à partager et à comprendre ses émotions les plus fortes. Elle nous présente ses nouveaux amis, sorte de club des six qu’elle a rencontrés au café en face du Palais de Justice, victimes et avocats et même un avocat de la défense (d’un accusé) dont elle comprend le rôle et accepte l’humour dévastateur.
Livre passionnant lorsque comme moi on s’intéresse à ce qui se passe dans la tête et le cœur des gens dans les circonstances les plus inhabituelles, les plus dures, les plus dramatiques ou extraordinaires.
Déplier le cœur d’Aurélie Silvestre, 2025 aux éditions du Seuil. 270 pages, 20,50€
Texte © dominique cozette