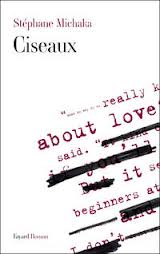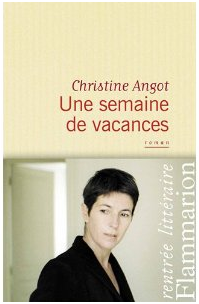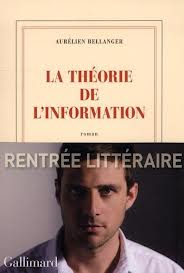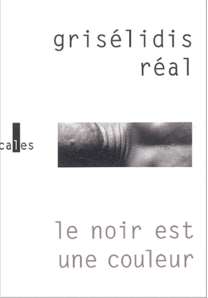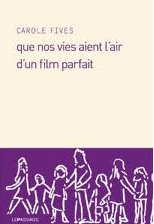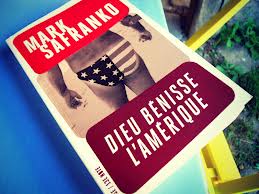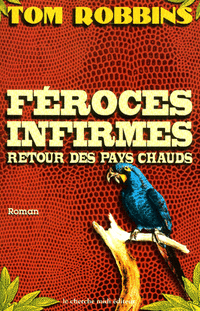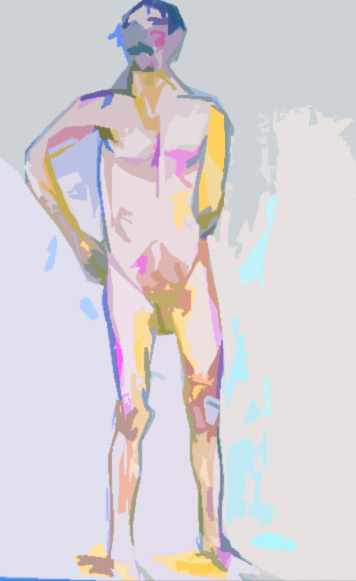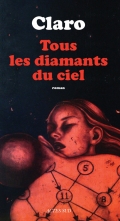
Claro est un écrivain et un sacré traducteur, pas de n’importe qui : Rushdie, Palahniuk, Selby, T. Vollmann, Pynchon…
Avec son dernier livre Tous les diamants de ciel, je vacille dans une friche de mots, d’idées, d’inventions, d’hallucinations inouies. D’ailleurs, pas étonnant, le personnage principal en est le L.S.D qui transite autour des deux marionnettes d’un destin foireux. Pour les deux, l’histoire commence en 1951. Antoine, pauvre moineau orphelin limite mytho, mitron à Pont Saint Esprit, jolie bourgade d’Ardèche, se prend de plein fouet l’incroyable trip qui va mettre à mal toute la population sans qu’on sache exactement comment le pain qu’il a peloté a pu produire ces hallus mortelles. Il y serait question d’une manip de la CIA qui teste ainsi, sur des cobayes lambdas, des sortes d’armes chimiques.
Très loin de là, Lucy, barrée de chez elle à 15 ans, petite pute junkie, est repérée par un homme de cette même entreprise pour d’autres essais sur ses clients. Là, je vous dis pas, c’est d’un sordide accompli qu’en termes poético-créativo-rocks l’auteur nous narre.
Puis on saute en 67, à San Francisco, où la jeune beauté, protégée par son démon-gardien, s’est réfugiée incognito. Elle se marie, fait un môme, adopte une posture bourgeoise, bref, disparaît de la terrible liste létale de la CIA. Puis elle est priée d’aller tester ailleurs, de toute façon c’est sa vie et elle n’aime pas son gosse. On la retrouve un peu partout où se joue l’histoire de la dope et des bouillonnements culturels pointus, Berlin, Londres et Paris, où elle tient la première sex-shop de France. Toujours entre deux shoots, elle rencontre Antoine entré par erreur dans l’échoppe. Lui, c’est plutôt les églises, le divin, pas le divan et surtout pas le cul. Naîtra un sentiment fort, mêlé et entêtant, sans rapport avec ce qu’on connaît (enfin, je dis ça, je ne sais pas pour vous). Antoine raconte ce qu’il a fait entre-temps, il aurait été parmi les premiers bidasses à assister aux essais atomiques français, cobaye encore… Ce n’est pas aussi vrai.
Je ne vais pas vous raconter l’histoire, c’est de la dentelle hérissée de noeuds, bouffie de grumeaux, concoctée à partir d’un écheveau emmêlé, c’est tordu, c’est plein d’âcreté, d’odeurs, de chair, de volutes et de conspirations, de soupçons, de défonces, de détails réels embringués dans des délires de ouf. C’est dingue. Je vous jure ! Un sacré trip !
Claro. Tous les diamants du ciel chez Actes Sud, 2012, 250 pages.
Texte © dominique cozette