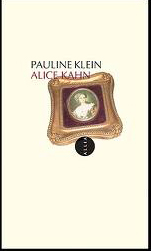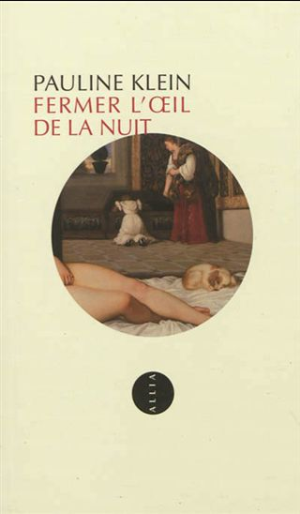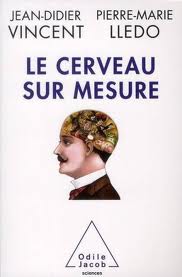C’est le deuxième opus de notre homme Flynn qui avait commis le très fort « encore une nuit de merde dans cette ville pourrie » où il racontait comment il avait retrouvé son père dans un carton à la rue alors qu’il bossait dans un samu social.
De nouveau, il écrit sur lui, il écrit surtout sur ses questionnement. Une enfance pourrie, une mère qui s’est suicidée, une vie d’addiction à toutes sortes de saloperies, un père idem mais en pire, qu’il ramasse dans la rue dans le livre précédent et qu’il essaie de sauver encore dans celui-ci.
Actuellement clean, à part quelques petits rails par ci par là, il attend avec angoisse son premier enfant. C’est une fille. L’angoisse, c’est de ne pas savoir s’y attacher, de rester indifférent. Il aime la mère, il l’a aimée en même temps qu’une autre femme, c’est la grossesse qui a déterminé du choix entre elles.
Mais le thème majeur du livre est la torture. Lorsqu’il découvre que non seulement la torture est largement pratiquée par son pays, mais encore étudiée, peaufinée, il na de cesse de se renseigner sur le sujet, la prison irakienne d’Abou Ghraïb, les soldats hommes et femmes humiliant les prisonniers par des techniques éprouvées. Pour se laver de cette extrême mauvaise conscience, il se rend à Istanbul pour y interviewer des victimes de ces actes sans nom.
Ce livre est composés de fragments, il n’est pas linéaire. La date apparaît à chaque début de chapitre et l’ordre chronologique n’est pas respecté mais qu’importe, on ressent d’autant plus fort l’humanité impuissante de l’auteur. On y touche aussi du doigt l’évolution psychologique du futur père par rapport au sien qui n’avait pas l’air si heureux de le tenir sur ses genoux sur une photo retrouvée. Alors que de lui émane un tel bonheur total … sur les toutes premières photos. Car ensuite, plombé par les nuits blanches, c’est visible, il se demande si son père n’était pas juste fatigué, comme lui.
Très beau livre.
Nick Flynn. Contes à rebours, 2010. 2012 pour l’édition française chez Gallimard. 324 pages dont plein de notes intéressantes à la fin.
Texte © dominique cozette