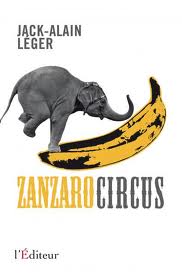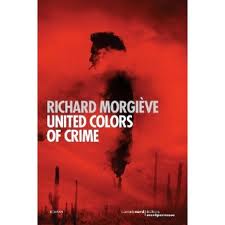C’est un gros pavé de 2011 et de 700 pages de Jonathan Franzen dont je n’étais pas venue à bout des Corrections, parfois j’ai le cerveau si mollasson qu’il refuse toute course de fond, car c’en est une avec cet auteur prolixe. Sous le pavé, point de plage, hélas, mais une histoire terriblement american way of life qui compte trois générations de personnes de la middle-class à tendance variable, le noyau étant Patty, sorte de desperate housewife dont on nous conte les grands parents, les parents, puis l’enfance du mari, Walter, issu de Suédois. On assiste à des dialogues de sa jeunesse lorsqu’elle était preppy, puis à ses premiers pas dans l’amour où elle loupe le bad boy rocker, blasé et queutard, meilleur ami de Walter qu’elle épousera donc par capillarité. Puis on verra comment elle se demandera plus tard si elle n’a pas gâché sa vie en faisant le mauvais choix et si elle devrait pas, finalement, passer à l’acte avec cet homme toujours séduisant qui continue à lui faire du gringue. Mais je ne vous dirai rien.
Walter, le desperate houseband, c’est l’homme bien, digne et probe, non buveur ni fumeur, travailleur, rougissant facilement, bref un brin chiant, mais sûr. Qui un jour décidera de protéger la nature par le biais de tout petits piafs qui s’éteignent à cause de cette chierie de civilisation américaine. Ce qui va l’entraîner dans de drôle d’aventures où son désir jusqu’alors très sage, s’inscrira dans une sorte de redressement productif pour une jeune associée, partie très prenante dans ce combat écolo. C’est extrêmement documenté sur le problème (et divers autres) et je ne saurais trop conseiller à nos amis lecteurs, oui, toi, chère abonnée et toi, vieux facebooker, de ne plus laisser traîner ton chat adoré dehors* tant cela fait des ravages dans la faune fragile (150 millions d’oiseaux tués chaque année aux Etats-Unis, sans compter les petits orphelins crevant de fin dans leurs nids funéraires).
Bon, trêve d’endoctrinement, ce couple a des enfants. Devinez quoi ? Un gars, une fille. Totalement différents, au destin totalement opposé et pas complices. Naissance de moult problèmes avec eux car, comme vous le savez, la mère américaine a tout d’une mère juive en plus juive encore. Elle culpabilise très facilement, se pose mille questions dont on profite grave et se perd en conjectures heu je cherche un adjectif mais n’en trouve pas (je veux dire qui se renouvellent constamment comme les vagues de la mer, vous voyez le genre).
Si vous aimez vous noyer dans un flot de prose qui passe tout en détail, qui ne vous donne pas le confort de petits paragraphes et de lignes espacées, plongez dans ce bouquin — je ne sais pas s’il est sorti en poche (c’est plus une poche, c’est un cabas) —, si vous aimez décortiquer les noix, les crabes et les pattes de langoustines jusqu’au plus pointu du fond, cet ouvrage est pour vous. Autre avantage de poids, si je puis dire : il évite à la serviette de bain de s’envoler au premier coup de mistral.
Dernière remarque : quand on le finit, on émet un discret ouf car ce bouquin, c’est un peu comme avec les enfants en vacances : on est content quand ils arrivent mais on est content quand ils s’en vont. Je blague, bien sûr, un enfant, on est toujours obligé de le finir !!!
* le dialogue est absolument réjouissant entre une voisine revêche et Walter dans leur environnement de nature préservée où chacun fourbit ses arguments pour et contre les errements félins, morceau d’anthologie sur le comportement type je-fais-ce-que-je-veux-et-je-t’emmerde, en moins discourtois mais tout aussi agressif.
Freedom de Jonathan Franzen aux Editions de l’Olivier, 2011.
Texte et illustration © dominique cozette