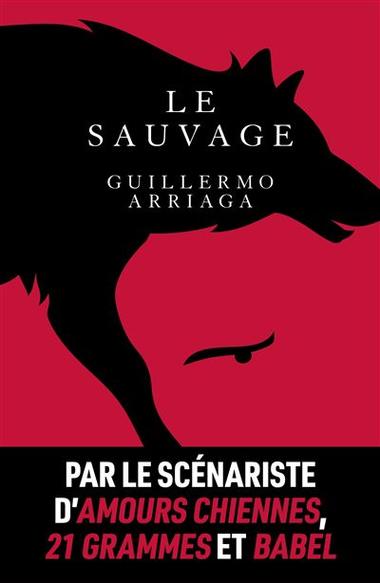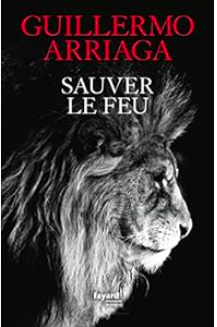
Guillermo Arriaga est une sacrée plume, un sacré storyteller. Il a imaginé des scénarios époustouflants pour Alejandro Inarritu comme, entre autres, 21 grammes, Babel ou Les amours chiennes. Ce roman, Sauver le feu, est du même tonneau. Une densité extraordinaire, une inventivité énorme, des situations insensées, des rebondissements incroyables, tout ceci baignant dans la violence terrifiante, explosive, du Mexique, en proie à la guerre des cartels, des combines des prisons et de la corruption politique.
Au milieu de cette pourriture, vibrionnant dans les bas-fonds du pays, une histoire d’amour insensée, totalement taboue, entre un puissant condamné craint de tous, ayant assassiné son père (un sale type) de façon cruelle, d’un charisme au-delà de l’humain et une riche bourgeoise, belle, mariée et mère, cheffe d’un ballet expérimental dont elle va présenter la dernière œuvre à la prison. Où se fera la rencontre improbable mais indéfectible.
Ce qui est passionnant ici, c’est l’alternance entre les différentes voix des narrateurs. Il y a le « je », c’est elle Marina qui raconte sa partie. Il y a les pages en italique qui sont celles du frère de l’assassin : il s’adresse à leur père assassiné, il retrace la cruauté de l’éducation, du dressage plus justement, qu’il a exercé sur eux, comprenant outre la violence physique, le bourrage de crâne car il voulait que ses enfants sachent tout : latin, philo, maths et tout ce qu’il faut connaître pour être les meilleurs. Parce qu’il était descendant des Indiens assassinés par les Espagnols, d’où besoin de vengeance… La troisième voix est celle du narrateur, neutre, informative sur les événements qui se déroulent tambour battant. Et la quatrième, sur le mode typewriter, celle de prisonniers lors des ateliers d’écriture.
Comment vivre des amours interdites et clandestines quand l’un est enfermé sous haute surveillance et l’autre libre mais coincée par ses devoirs maternels et sociaux ? Ils auront des aides, dont le couple gay ami de Marina, mais des ennemis implacables. Les têtes vont tomber autour d’eux, les gangs vont se trahir à tour de bras mais surtout de dollars, ça n’arrête pas, c’est trépidant et je dois dire que, vu le vocabulaire utilisé dans certains groupes, je tire mon chapeau à la traductrice qui a réussi à caser « ça m’en touche une sans faire bouger l’autre » parmi l’étendue de son vocabulaire déjanté. Chapeau (mexicain) les artistes ! Ce roman qui en contient plusieurs est palpitant, addictif, un des meilleurs que j’aie lu cette année. Un exploit, je dirai, tellement il nous apprend de choses, aussi. Seul petit hic : il est lourd, faut avoir des biscottos ! Bon, on en a, ça tombe bien.
Sauver le feu par Guillermo Arriaga, traduit pas Alexandra Carrasco. 2023 pour la version française aux Editions Fayard. 760 pages, 26 euros.
Texte © dominique cozette