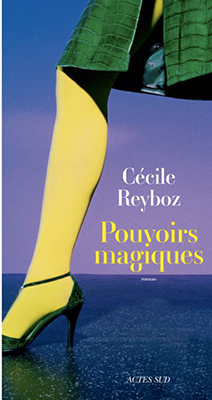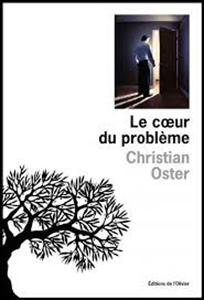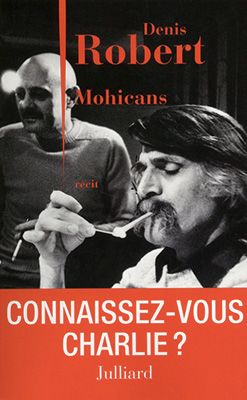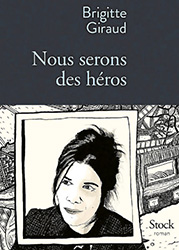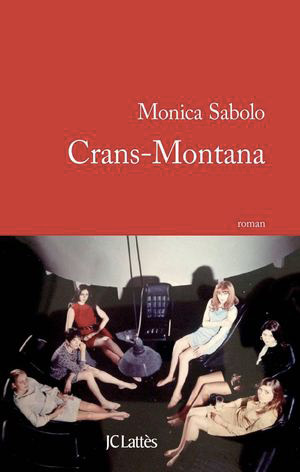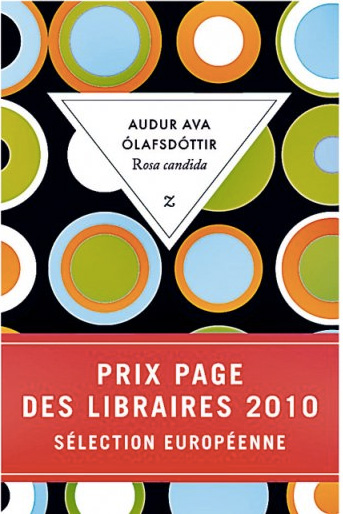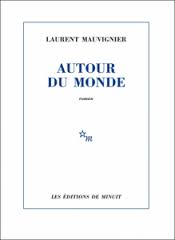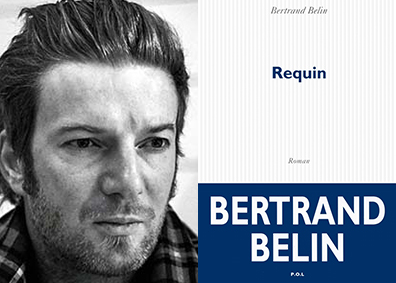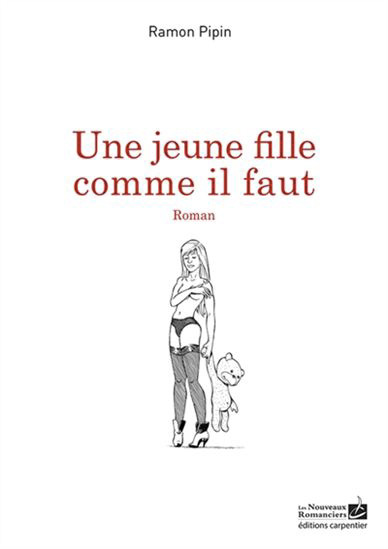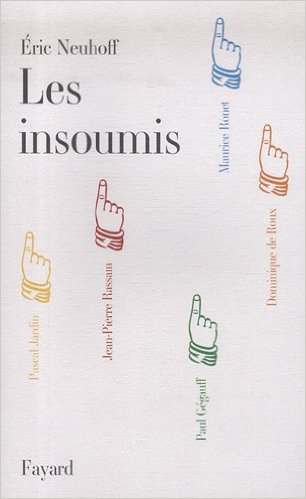
Je ne sais pas si le bandeau rouge « prix Vaudeville 2009 » n’a pas nui au succès de ce livre qui n’a rien de tel à revendiquer. Il s’appelle les insoumis. Son auteur, Eric Neuhoff, nous conte non pas l’histoire, mais la gangue de sulfure attachée à cinq personnages hénaurmes, tous morts avant l’heure mais sans suicide. Il s’agit de Maurice Ronet, Jean-Pierre-le-rastaquouère-Rassam, Pascal Jardin, Paul Gégauff et Dominique de Roux. Je ne connais pas ce dernier qui était dans l’édition. Tous les autres étaient dans le cinéma et/ou le livre. Signalons que Jardin a écrit plus de 100 films (en plus de ses livres) et Gegauff un certain nombre que l’on a vus et revus dont beaucoup de Chabrol. Que la bête meure, il l’a adapté de Nicholas Blake et le trouve nul. Bon.
Les insoumis ne révèle rien de scandaleux, le scandale est ailleurs, c’est eux, c’est leur folie, leurs excès, leur mépris des codes de toutes sortes. Leur talent étant bien sûr indissociable de leur vie de patachons. On connaît toutes le beau Ronet, on se serait toutes damnées pour lui mais on aurait eu tort, car, passé le premier émerveillement, on aurait été forcément très malheureuses. Gégauff, lui, a inventé le dîner de cons et plein d’autres jeux à la con. Doué pour se foutre de la gueule des autres.
Pour tous, c’était les bitures avec les mêmes bandes de complices, les bons vivants du cinoche, les éternels fêtards, bourlingueurs, baroudeurs de la nuit, cyniques de l’amour, bouffeurs de la vie et assoiffés de sensations. La drogue aussi, pas tous, et les femmes dangereuses, comme Gegauff qui mourut lardé de coups de couteau le soir de noël par sa très jeune femme, ou des femmes uniques comme Jardin, d’autres plus nombreuses comme Ronet ou plus éclatantes comme Rassam avec Carole Bouquet. Tous se fichant pas mal du reste. Jouir d’abord, jouir c’est tout. Claquant tout le fric qu’ils avaient su faite couler de leur source fertile, par la grâce d’un don. Êtres exceptionnels, littéralement.
Ce bouquin, court, en cinq chapitres, m’a plu par son explosion de formules et de saillies qui, si elles ne racontent rien de l’ordinaire de ces bougres-là, en dessinent l’ambiance générale, le spectre, l’aura. De façon brillante. C’est un livre qui me file la nostalgie de quelque chose que je n’aurais jamais pu vivre car ce n’était pas mon époque, ni mon tempérament. Et puis je ne suis qu’une simple femme. Les femmes ne vivent pas comme ça.
Des portraits brillants, pressés, denses, de mecs fêlés, excellente compagnie pour passer gaiment une poignée d’heures. Remettez-nous ça, patron.
Les insoumis par Eric Neuhoff chez Fayard. 2009. 170 pages, 16 €. (Pas facile à trouver, par ailleurs.)
Texte © dominique cozette