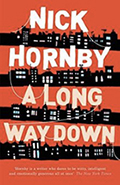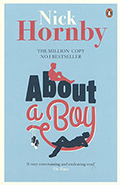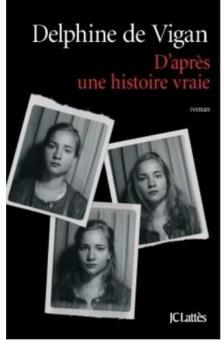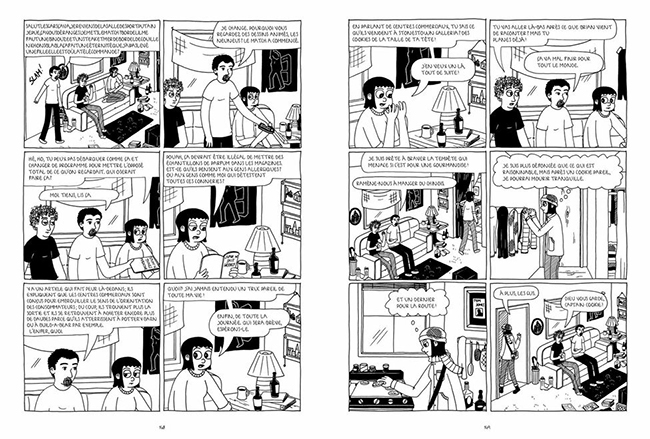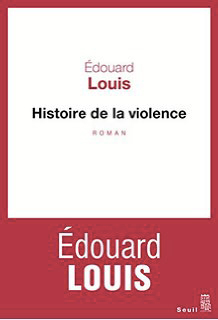Au pays du p’tit dernier, opus de Nicolas Belle Gueule Fargues (voir photo hé hé) ne parle pas d’un endroit où aurait été élevé un petit garçon, pas du tout, mais de notre beau pays la France. Car ici, on ne peut s’empêcher de se basher, de tout minimiser ou critiquer et que donc, tout est vu petit : petite virée, petit café, petite bouffe etc…
Dès le départ, le livre peut laisser pantois : est-ce un bon livre, est-ce un bouquin insupportable écrit par une tête à claques prétentieux ? On ne sait pas. En tout cas le héros l’est, sacrément prétentieux. Queuteur de première et prédateur majuscule, cynique absolu ayant tout vu et connaissant sur le bout du prépuce la moindre minette, ce qu’elle va dire / faire, comment ça va se terminer. Il s’en bat les ventricules car la morale et la délicatesse sont les moindres de ses soucis. Il ne voulait pas d’enfant mais il en a un qu’il néglige, il ne veut pas d’attaches mais il a une (deuxième) femme amoureuse qu’il trompe allègrement mais à qui il envoie des SMS gentils pendant une scène de fesses. Comme on dit dans la culture télévisuelle « on ne se projette pas » dans une telle histoire.
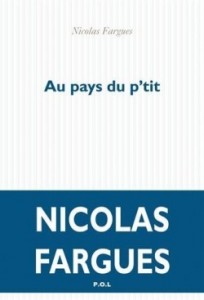
Le bon côté du livre, c’est que le narrateur est sociologue et qu’il a décortiqué dans son livre en promo une critique terriblement acerbe et caricaturale de notre société française actuelle, avec tous ses petits et gros travers (de porc), ses tics, son auto-dénigrement qui empêchent le pays de s’en sortir, de penser positif. A le lire, on rit beaucoup et très jaune, pour le coup on s’y identifie et ça fait mal aux seins ! Il décrit tellement bien tout ça qu’on a envie que le livre existe.
Sinon, il y a aussi une histoire de sexe avec une jeune étudiante russe qu’il rencontre lors d’un colloque à Moscou et à qui il va donner une bonne leçon de séduction. Monsieur je-sais-d’avance-tout-sur-les-nanas se comporte d’une façon extrêmement calculatrice — avec les prix de tout ce qu’il dépense luxueusement pour l’épater tout en la méprisant — en même temps il s’inquiète de ses nouveaux troubles de l’érection même s’il n’a que la quarantaine, et de sa peau qui se relâche ! le bellâtre. Mais les filles les plus connes ne sont pas plus connes que les mecs les plus nases et elle ne lui envoie pas dire. Aïe, ça va faire mal !
C’est du Nicolas Fargues, bien écrit, bien ficelé et même fignolé, ça se lit sans faim.
Lien sur un autre texte sur Fargues ici.
Au pays du p’tit de Nicolas Fargues, 2015 chez P.O.L. 233 pages, 16 €.
Texte © dominique cozette