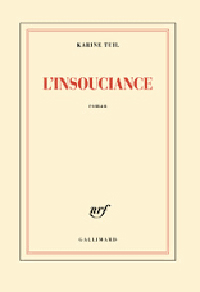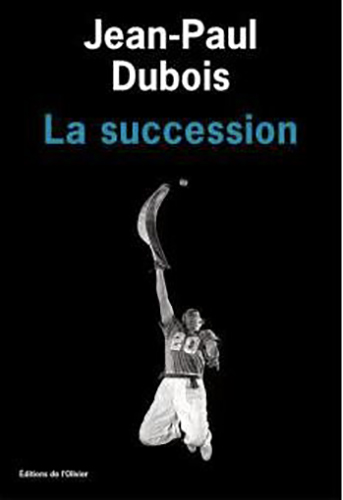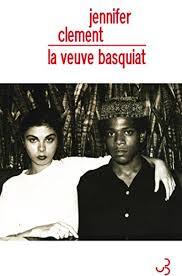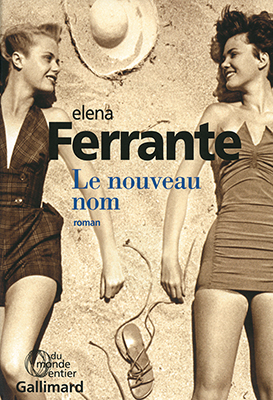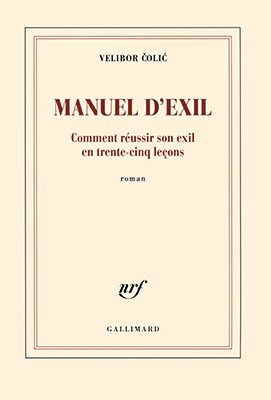
Le titre réel de ce livre plein d’esprit et de dérision est Manuel d’exil avec ce sous titre comment réussir son exil en trente-cinq leçons, il est écrit en français par Velibor Colic (avec des petits zigouigouis sur les C) et il est impayable, bien que dans la très sérieuse collection blanche de Gallimuche.
Ce mec est un géant d’1m95, c’est vous dire que pour passer inaperçu quand on est un sans papiers, c’est coton. La première phrase du bouquin donne le ton : « J’ai vingt-huit ans et j’arrive à Rennes avec pour tout bagages trois mots de français — Jean, Paul et Sartre. » On le traite comme un illettré sourd en lui parlant fort et simple bien qu’il avoue bac plus 5 et qu’il a déjà écrit quelques livres en serbo-croate. De plus, il se trimballe partout avec ses livres, Camus, Sartre, Cocteau, il est pétri de culture française, de références poétiques, cinématographiques, littéraires. Des humanités. Il a donc droit aux leçons de français. Mais celles-ci menacent de durer des semaines tant que tous les réfugiés n’arrivent pas à dire « où est la poste ? ». Du coup, il préfère pratiquer sur les bancs publics ou dans les bistrots où les patrons sont assez sympas pour ne pas le virer quand il n’a pas de sous. Il loge dans des refuges assez rêches et se trouve des amis de galères plutôt bruyants et portés sur la bouteille. Ses amours sont réduites à pas grand chose car c’est pas facile de séduire une jolie fille quand on est attifé chez poubelle, coiffé à la footeux, pas très clean et sans un.
Ses pérégrinations commencent à Rennes et il fera un bon tour en France dont Paris, puis Italie, Venise, et retour au pays natal où il n’y a rien à espérer. Donc retour en France.
Il apprend que pour trouver les épiceries les moins chères, il suffit de suivre les grosses mamas africaines. Ou comment gruger le système allemand avec ses Länder pour recevoir plusieurs fois les allocs. Un copain a une combine pour fabriquer des billets de 20 € mais ça coûte 24 € le billet, etc.
Puis un jour, le voilà invité par le Parlement européen des écrivains aux côtés de célébrités tels que BHL qui ne font pas grand cas de lui. « Je me retrouve dans ma posture habituelle de hérisson mental. » Il possède une Olivetti portable et tape tout, d’un café ou de sa chambre à Clichy ou d’une piaule n’importe où ailleurs. Il mange des glouches, fume et boit quand il le peut. Il souffre de solitude, il voit bien que la vie n’a pas été sympa avec lui et malgré cela, il trouve suffisamment d’humour pour nous faire partager ses misères sans que les larmes montent aux yeux. Cerise sur le non-gâteau : son style est formidable !
Manuel d’exil. Comment réussir son exil en trente-cinq leçons de Velibor Colic chez Gallimard, 2016. 200 pages, 17 euros, même pas 10 centimes par page, ce qui est donné.
Texte © dominique cozette