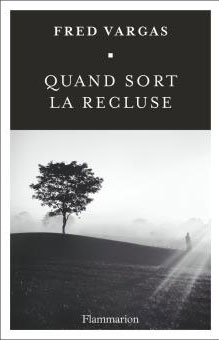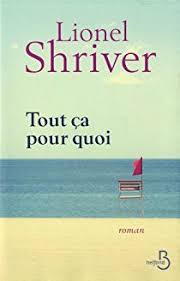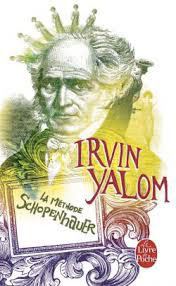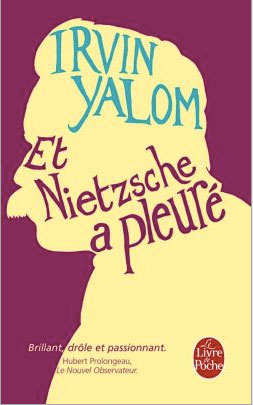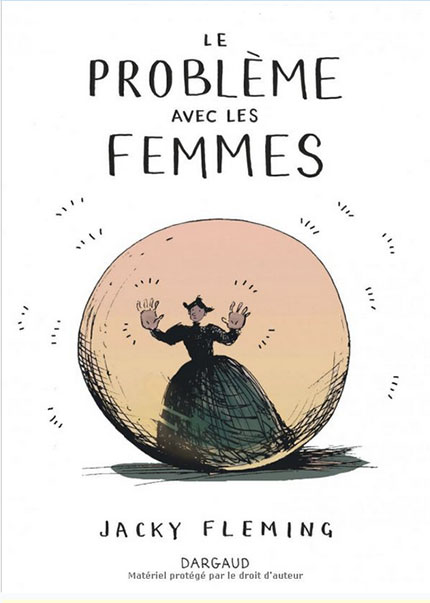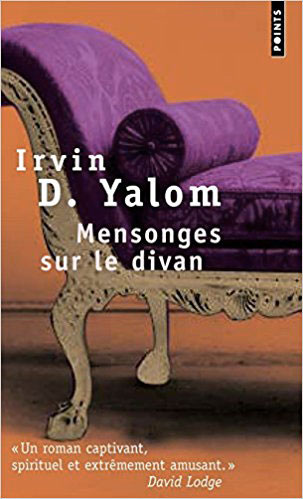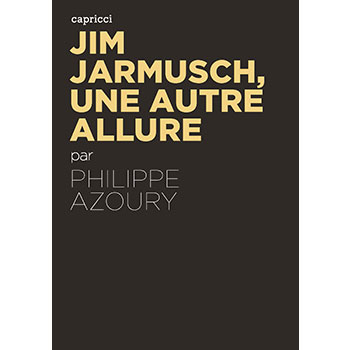Elle est américaine, morte en 2004 à 68 ans, et un peu connue depuis qu’est sortie récemment une compile de ses récits et nouvelles. En commençant ce gros livre, Manuel à l’usage des femmes de ménage, je croyais qu’il s’agissait du roman de sa vie tumultueuse, or ce sont des nouvelles, des récits, dont les sujets sont largement empruntés à son expérience. Mais pas que (expression idiote). La bio de la dame se trouvant bêtement en fin de livre, on se fait des idées fausses. Mais en tout cas, l’écriture, c’est du brillantissime. Les portraits, le cadre, les événements sont brossés avec un réalisme très original, très agréable, qui nous donne à voir des petites choses pointues, des petites couleurs, des sons. On la compare à Carver, non parce qu’elle lui ressemble mais par le talent qu’elle déploie à raconter des choses simples.
Elle nous plonge dans un univers très personnel et attachant car c’est beaucoup d’elle qu’il s’agit. Un oncle trop sympa, un grand-père farfelu, sa sœur, dont elle fut longtemps séparée puis jalouse, victime d’un cancer, qui lui demande de venir vivre près d’elle à Mexico. L’amour va naître entre elles deux de belle façon. Son grand-père, riche dentiste bordélique, lui demande un jour de l’aider à s’arracher toutes ses dents !
On retrouvera aussi l’univers hospitalier où elle a travaillé, parfois du côté des soignants, parfois du petit personnel, parfois des victimes, crack, mauvais traitements. Bien qu’elle ait vécu quelques temps avec les moyens, elle raconte plutôt les précaires, les univers décadents, les difficultés de la vie, qu’elle a beaucoup côtoyés. Il y a de tout.
En vrai, elle a épousé plusieurs hommes, souvent des artistes, sculpteurs, musiciens dont elle a eu plusieurs fils, mais elle néglige ces milieux aisés, en tout cas dans ce recueil, et nous montre des compagnons moins enviables. Cependant, le corset horrible qu’elle doit porter en permanence depuis l’enfance trouve place dans ses histoires, comme la prison et ses ateliers d’écriture, l’alcoolisme, dont elle-même comme son entourage furent victimes. Ce livre est aussi l’état des lieux décapant d’une certaine Amérique, étalé sur une vingtaine d’années, de 77 à 99.
Manuel à l’usage des femmes de ménage (A manual for cleaning women), de Lucia Berlin, de 1977 à 1999. Traduit de l’anglais par Valérie Malfoy. 2017 aux éditions Grasset. 558 p., 23 €.