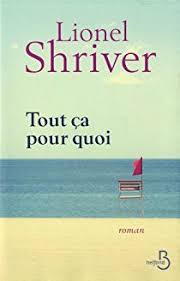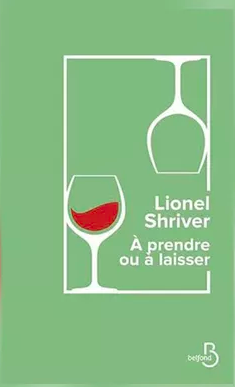
Oui, vous avez bien lu. A quatre-vingts ans, Kay et Cyril doivent prendre le fameux médoc qui vous emmène en douceur dans l’au-delà. Ils ont décidé ça à la cinquantaine, lorsque le père de Kay a fini par mourir suite à un interminable Alzheimer bien crade et bien repoussant. C’est le thème du nouveau roman de Lionel Shriver (c’est une écrivaine pour ceux qui l’ignorent qui a commis de nombreux et fort passionnants livres dont Il faut qu’on parle de Kevin). Je l’adore.
Celui s’intitule A prendre ou à laisser. Ils ont trois enfants dont une fille genre pénible, un premier de la classe genre mou-mou et un petit dernier genre glandeur-profiteur. Sinon lui est médecin, il connaît donc bien les médocs et elle infirmière, d’abord, puis a changé pour décoratrice. Chez l’autrice, les caractères et la psychologie sont terriblement fouillés. Pas de raccourcis, pas de travers laissés dans l’ombre. L’humain, elle s’y connaît jusqu’au moindre détail.
Alors donc les années s’écoulent, assez vite, jusqu’au fameux anniversaire des quatre-vingts ans de Cyril, Kay les a déjà eus, date butoir, on n’y coupe pas, alors qu’elle se demande si c’est bien raisonnable d’agir ainsi. Elle n’est pas très convaincue de la décision prise il y a si longtemps. Ils sont en forme même si lui fait semblant d’aller mal et de souffrir de divers troubles du vieillissement, et si elle a quelques trous de mémoire comme tout le monde. Mais les choses sont en route, ils ont dépensé leurs économies et même mis une hypothèque sur leur maison afin que profiter au maximum de leurs dernières décennies. Et ce fameux soir, on y est, ils ont ont mis les petits plats dans les grands, choisi un bon vin et mis de beaux habits.
Mais comme elle a peur de survivre à son mari, des fois qu’elle supporte mieux le médoc que lui, il lui propose de prendre la pilule la première tandis qu’il la tiendra dans ses bras. Et lorsqu’elle sera morte, ce sera à lui de partir.
Mais les choses ne se passent pas vraiment comme ça. D’ailleurs, les choses peuvent aussi arriver autrement, il y a des possibilités à envisager, une douzaine, et c’est ce que nous raconte l’autrice avec tout son talent de dramaturge mâtiné cocasse.
A prendre ou à laisser de Lionel Shriver, traduit par Catherine Gibert (Should we stay or should we go, 2021). 2023 aux Editions Belfond. 286 pages, 22 €.
Texte © dominique cozette