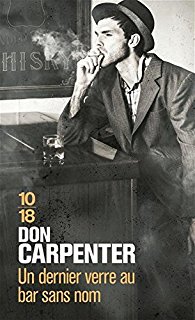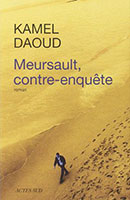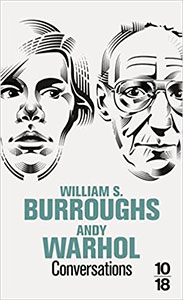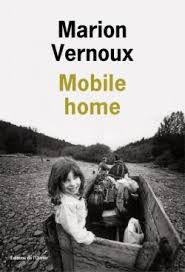
Avec Mobile home, Marion Vernoux se livre. S’appuie sur les meubles qui ont jalonné sa vie pour se raconter. Mais qui est Marion ? Marion est une réalisatrice que j’ai connue sur un tournage de pub dans les années 90 ou début 2000 peut-être. Pour un yaourt ou un dentifrice pour mômes, je ne sais plus. En tout cas, elle m’a bien plu, cette Marion, sympa, drôle, en salopette, sans façon, qui ne crachait pas sur des petits verres de vin lors des repas et surtout qui connaissait toutes, TOUTES !, les chansons de Bobby Lapointe qu’elle chantait avec sa productrice qui les connaissait aussi. Ça vous pose quelqu’un, ça. A l’époque, elle était encore l’épouse, ou la compagne, de Jacques Audiard, la mère de leurs deux filles mais pas encore de leur petit dernier, un petit pour la route puisque apparemment les choses n’allaient plus entre eux et qu’il fut conçu par négligence. Bons souvenirs de ce tournage donc. Et bonne impression par rapport à son film Personne ne m’aime sur la condition féminine et les râteaux infligés par ces messieurs. Mais déçue par A boire, qui se passe à Val d’Isère, avec Emmanuelle Béart en pochetronne. Qui fut hélas un bide dont elle a du mal à se remettre.
Le livre de Marion est extrêmement touchant même si parfois il y a quelques longueurs sur les recettes maternelles. Touchant parce que par le biais de ses meubles, elle y raconte ses gamelles. Beaucoup de gamelles. Ses regrets. Beaucoup de regrets. Ses ratages. Ses peurs. Ses chagrins. Dont le plus dur est la rupture d’avec son mari. Elle lui a demandé l’autorisation d’écrire sur lui, il n’a pas dit non mais elle pratique une certaine censure. Ce qu’on peut comprendre. Leur entente fut parfaite malgré un certain machisme, un manque de tendresse. Comme ça a du être difficile aussi de voir que dans leur couple, l’un monte vers les hautes récompenses alors qu’elle stagne, voire se plante ! Ils se sont trouvés tous les deux nommés dans une même catégorie à Cannes, c’est lui qui a ramassé la mise. Il a tout ramassée et elle s’est ramassée.
Sinon, sa mère qu’elle adorait, sa mère au gros cul, qui bossait dans le cinéma (casting) mais l’a mis de côté pour faire des costumes et d’immenses patchworks. Le livre, d’ailleurs, est un réel patchwork. Des morceaux assemblés sans ordre chronologique, c’est un peu gênant mais c’est comme elle, limite bordélique, impulsive, faut que ça sorte. Donc sa mère qui meurt d’un cancer, un père avec qui elle renoue, qui meurt, des parents éloignés qu’elle tente de retrouver pour comprendre le puzzle de leur histoire, les camps, la shoah, les secrets de famille. Les enfants qu’elle élève à la va comme je te pousse, entre les sorties tous les soirs, les fêtes très arrosées et la came. C’est cash, franc, direct. La nana, garçon manqué sans un gramme de féminité ou de coquetterie, nous met tout ça sur la table et à toi de reconstituer le bazar.
De cinéma, elle parle peu, incidemment j’allais dire. Ce n’est pas son parcours professionnel qu’elle nous fournit, passant sous silence les récompenses qu’elle a gagnées (vu sur wiki). Elle s’était donné pour objectif de finir le livre pour ses 50 ans. Chose faite. Elle en a donc 51 et un nouveau film va bientôt sortir. De ça, elle ne parle pas non plus. Enfin, bien qu’elle ait morflé, Marion ne se départit pas d’une sacrée dose d’ironie concernant sa personne. Et c’est bien réjouissant !
Mobile Home de Marion Vernoux. 2017 aux éditions de l’Olivier. 244 pages. 17,50 €.
Texte © dominique cozette