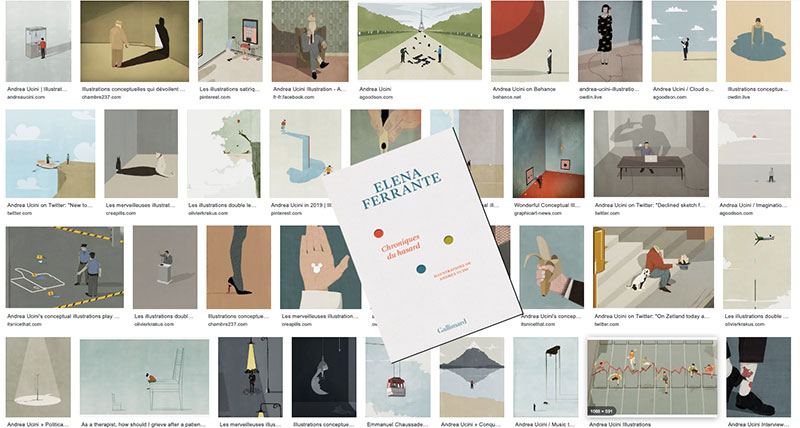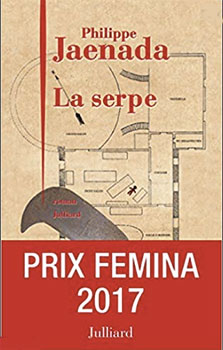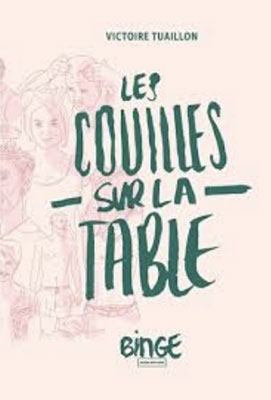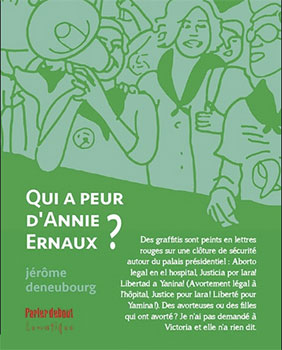Posy Simmonds a déjà réalisé deux histoires avec cette vieille bonne femme égoïste, très riche, escroque, sûre de ses idées, mais je ne les connais pas. Je découvre celle-ci appelée sobrement Cassandra Darke, du nom de la vieille portant chapka pour s’isoler de ses compatriotes qu’elle abhore, toute misanthrope qu’elle est. Elle a eu une belle galerie d’art avec son mari qui, un jour, s’est barré avec sa soeur, une belle fille. Depuis, elle négocie de l’art pour de riches collectionneurs, parfois de façon malhonnête, de quoi entretenir sa grande maison dans un quartier chic de Londres, sa cuisinière et son chauffeur. Mais un jour, la fille de sa soeur (et de son ex-mari qui agonise) lui demande asile. Peu empathique, la vieille refuse d’abord. Puis trouve une solution : OK, elle vivra dans le sous-sol aménagé mais exécutera les basses besognes comme promener le chien, aller chercher telle chose etc… La jeune fille est une artiste émergente, elle réalise des performances féministes sur le monde de l’art. Tout semble se dérouler parfaitement jusqu’au jour où elle se heurte à un dangereux prédateur et que, pour s’en débarrasser, elle donne le 06 de sa tante. S’ensuit une série de quiproquos dans des mises en scène choupinettes, des disputes, des empoignades et même une éventration de la vieille dame à l’arme blanche.
Cette BD est moins simplettes que je ne l’avais cru, ça pourrait être un chouette polar, les dessins sont super, les dialogues itou et on entre aussi dans le monde de l’art contemporain. Le plus important pour l’autrice, c’est d’illustrer (ce qu’elle fait brillamment) la fracture sociale de notre époque, aussi criante que sous Dickens qui la décrivait si bien. Cassandra finira-t-elle par voir l’énorme fossé qui sépare sa vie de nantie avec celle de pauvres hères qui croupissent dans leur vie de merde ? Ha ha…

Cassandra Darke par Posy Simmonds. 2019 aux éditions Denoël Graphic. 96 pages. 21,90 € pour l’édition limitée de noël avec tiré à part d’une image.