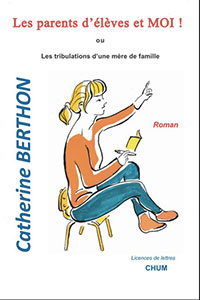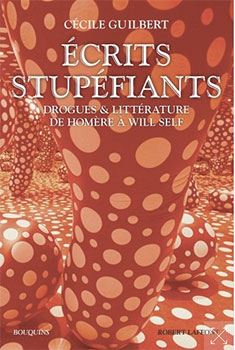En attendant demain, titre pas très parlant pour ce très beau roman de Nathacha Appanah que j’ai eu envie de lire après le formidable Le ciel par-dessus le toit (encore un titre qui ne livre rien !) dont j’avais fait un article tout récemment (voir ici).
Dès les premières lignes, on sait qu’un drame a eu lieu puisque Laura, la fille d’Anita, notre héroïne, ne peut plus marcher depuis quatre ans, cinq mois et treize jours, et que le mari, Adam, est en prison depuis la même durée, exactement. On part alors vingt ans en arrière. On est à Montreuil pour le réveillon mais ni l’un ni l’autre ne prise ce genre de fiesta. Ils se retrouvent dans l’ombre, sur un canapé où les invités déposent les manteaux. Et ils se parlent. Lui est un grand bel homme du sud-ouest, il est artiste peintre, ébéniste, bûcheron, marathonien. Et étudiant en archi. Elle est métissée, issue de l’île Maurice, ne se sent à sa place à peu près nulle part et rêve de devenir écrivain. Ils s’installent dans sa région, les Landes, près de la mer. Elle fait des piges sans intérêt pour un salaire de misère et lui réalise des maisons, des jardins, des meubles. Il a fabriqué de ses mains la maison qu’ils habitent. Ils sont heureux, tout est beau parce qu’ils savent apprécier la vie, les couleurs, les odeurs. Ils sont terriblement sensuels.
Puis l’enfant paraît, ils sont comblés. Anita est une maîtresse de maison parfaite. Quand elle invite leurs amis, ils sont éberlués par le goût qu’elle a de tout rendre beau. Ça leur donne envie de quitter la ville et de s’installer là, c’est tellement idyllique. Mais, des années plus tard, toute cette perfection finit par gaver ces mêmes amis, trop c’est trop. On n’en est pas encore là, mais on y arrivera. Le couple va s’user, elle est devenue maigre, elle ne ressemble plus à la jolie fille des îles, bohème, qu’il a aimée.
Jusqu’au jour où Adèle entre dans leur vie. Une femme plantureuse, hiératique, magnifique, qui remet des paillettes dans leur train-train. Elle est sans papiers et vient aussi de Maurice, ce qui créé des liens. Et alors, elle raconte son parcours, les accidents tragiques qui lui ont donné cette volonté de n’être plus personne. Elle a même changé de prénom. Et la vie est redevenue tellement douce avec cette femme que le couple reprend ses vieux rêves perdus : lui se remet à peindre, des choses incroyables, et elle commence enfin son livre… Et tout semble aller pour le mieux. Le succès est derrière la porte.
Mais voilà. Le mieux de durera pas. Le pire arrivera.
L’écriture de Nathacha est d’une suavité sans pareille. On respire ses parfums, on imagine ses couleurs chatoyantes, on ressent ses caresses, on entend sa vie riche des chants de la nature. C’est très beau. Ça serait très relaxant si on ne guettait pas le drame au bout de l’histoire. Elle est une amoureuse de la langue, de la vie, on se noie parfois dans ses petits bonheurs, on ne trouve parfois fade à côté de sa flamboyance. Un très beau livre !
En attendant demain de Nathacha Appanah. 2015. Aux éditions Folio Gallimard. 220 pages, 7,20 €.
Texte © dominique cozette