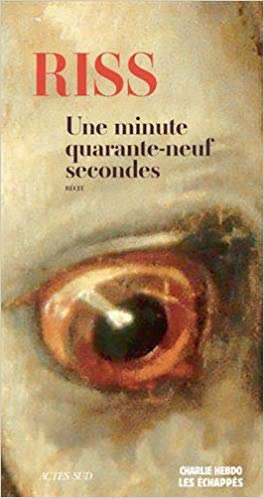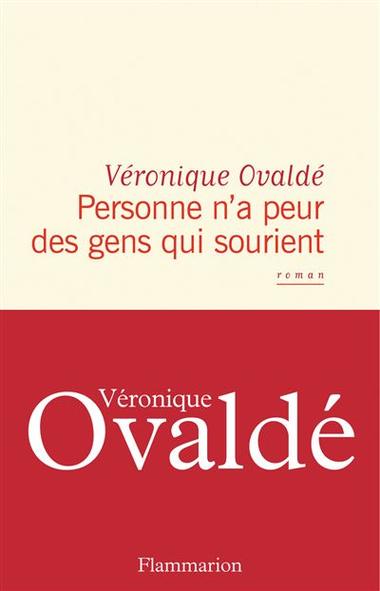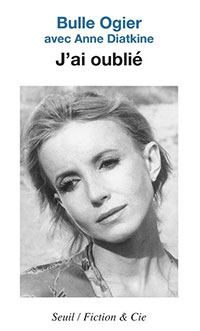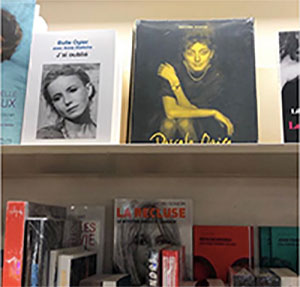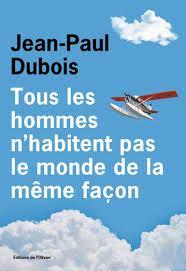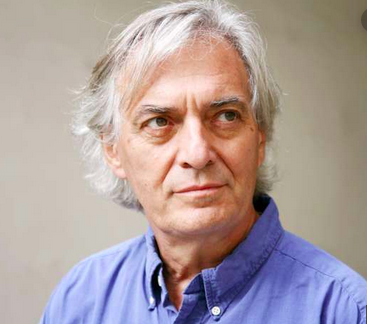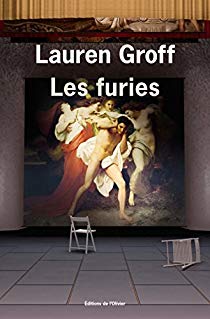J’aurais plutôt appelé ça : formation de la France depuis 20 000 ans, mais on ne m’a pas demandé. En tout cas, ce (petit) livre de Stéphane Durand, 20 000 ans ou la grande histoire de la nature est formidable, hyper passionnant, on y apprend une foultitude de choses sur la France depuis 20 000 ans, donc avant nous, les saccageurs, comment ça marche la nature, les plantes, les animaux, comment certains des animaux, gros ou minus, refont la géographie d’un lieu, changent le cours de l’eau (saviez-vous que la Seine passait du côté de Montmartre, jadis ?) etc. Pour dire qu’il parle de choses qu’il connaît, il y a 45 pages de références (pas des notes, juste des références) à la fin.
Très facile à lire car constitué de courts paragraphes rédigés comme autant de saynètes vivantes qui nous montrent l’utilité du castor dans la création de marais donc l’accroissement de la biodiversité, en particulier l’arrivée en France des chevaux sauvages et des aurochs, comment les blaireaux, les renards dispersent très loin des graines de plantes,comment le geai peut à lui tout seul créer des forêt en transportant 5000 glands par an, les cachant ici et là pour que ça dure toute l’année… Puis la mer, comment les harengs envahissaient la mer et sauvaient des milliers de vies les périodes de disette ou de jeûne, comment est apparue la surpêche au milieu du 16ème siècle car d’un coup, il fallait faire du fric et non plus se nourrir. Un jour, Louis XIV s’amusa avec un trident à tuer 14 thons, car ils grouillaient eux aussi, comment les riches chasseurs ont dégommé tous les macareux moines de Bretagne, même pas pour les manger, juste pour tuer (comme c’est étrange), comment les chapeaux des coquettes ont largement participé à la mort de millions d’oiseaux… Et tout cela s’imbrique dans la construction géographique de la France, les barrages qui détruisent plus qu’ils ne construisent, les forêts exploitées à mort puis replantées sans aucune diversité, trop proprement pour encourager la diversité. Il faut lire l’utilité énorme et méconnue des troncs d’arbres depuis leur chute sur le sol jusqu’à leur voyage dans la mer, en passant par les rivières. Il faut savoir surtout comment le fait de vouloir domestiquer la nature nous prive de ses ultra-nombreux bienfaits qu’on commence vaguement à déplorer. Mais rien n’est perdu…
Un point de vue plus professionnel que le mien : « Ce livre évoque avec émotion un monde perdu : la France. Une terre qui a connu il y a vingt millénaires les mammouths et les rennes innombrables, les lions et les ours des cavernes… Toute une mégafaune disparue, sous l’effet d’un réchauffement aggravé, peut-être, par la surchasse pratiquée par nos ancêtres. Alors que les mammifères géants disparaissaient, les forêts occupaient l’espace. Il y a dix millénaires, le tiers du futur territoire national est couvert de marécages. Les castors refaçonnent les paysages, les aurochs prospèrent dans les prairies humides, et des milliards de poissons, jusqu’à des esturgeons géants, animent les flots. Les saumons remontent les rivières et meurent en masse près des sources pour frayer, leurs cadavres apportant en altitude quantité d’azote et de phosphore, fertilisants, que les torrents redistribuent en aval. Puis arrivent les agriculteurs, en provenance de l’Est. Les vaches absorbent les aurochs par hybridation, la forêt recule sous le feu et la hache, le castor s’évapore. Au Moyen Âge, les moulins et les barrages brisent les cycles des eaux. C’en est fini des saumons, qui se voient interdire les sources où ils pondaient. Les humains se procurent désormais les poissons dans les mers, qui semblent alors inépuisables. En 1620, au large de Marseille, le roi Louis XIII s’amuse à pêcher au trident, en une seule journée, 25 thons rouges, une espèce aujourd’hui au bord de l’extinction.De nos jours, la nature agonise. L’agriculture industrielle l’a brutalement remplacée pour redistribuer azote et phosphore. Les marécages ont été asséchés, les forêts ne sont plus que monoculture d’arbres. Tous ces milieux présentent une biodiversité réduite, quand ils étaient autrefois les plus efficaces des puits de carbone. Alors que les menaces environnementales deviennent évidentes, nos connaissances en histoire environnementale nous permettent d’entrevoir les défuntes richesses des biotopes. »
Ce livre est passionnant, je vais entamer le prochain, dernier paru du même auteur, et vous dirai.
20 000 ans ou la grande histoire de la nature de Stéphane Durand. 2018 aux éditions Acte Sud. 250 pages, 22 euros.
Texte © dominique cozette hybridé quelque peu par le site scienceshumaines.com. (Ce qui est entre guillemets)