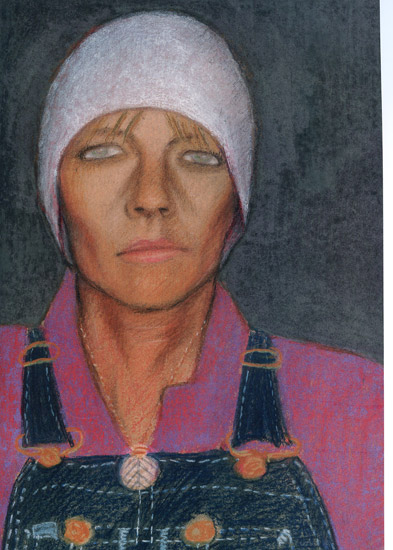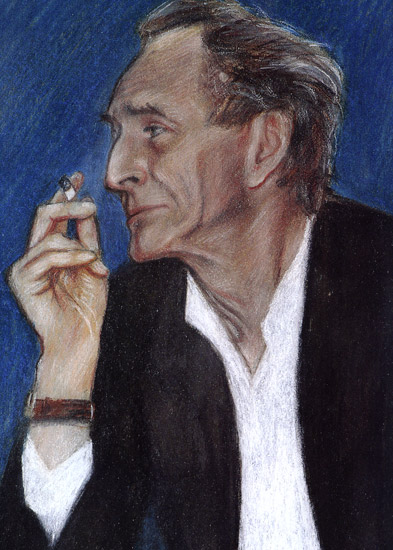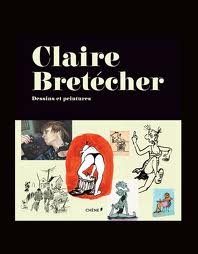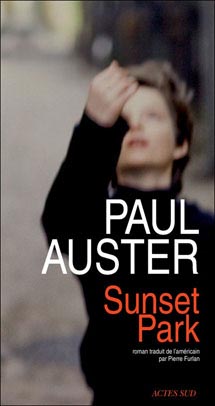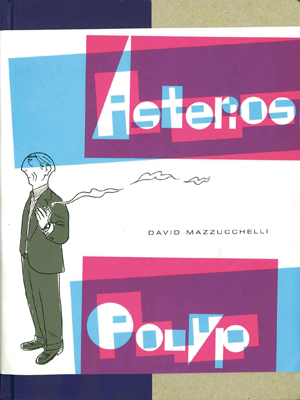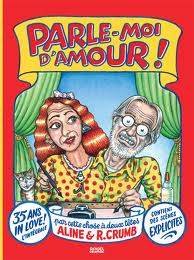Une copine tchèque m’avait fait acheter le bouquin remarquable de Patrick Ourednik, Europeana, une brève histoire du XXème siècle, petit ouvrage impressionnant qui nous raconte tout ça en raccourcis hilarants. Là-dessus, je tombe sur « Classé sans suite » à l’Arbre à Lettres, parmi les derniers bons ouvrages, la nana ne l’avait pas lu, j’achète, 9 € c’est pas non plus la fin du monde.
Premier chapitre, des chiffres et des lettres. Je suppose qu’on parle d’échecs.
deuxième chapitre : ça commence très fort dans la descriptions praguoise avec émanations de gaz carbonique, crotte de pigeon, écrasement de coléoptère, nana appétissante pour vieillard concupiscent. Au bout de quelques chapitres, malgré tout, ça se gâte, je ne sais pas trop où P.O. veut en venir, lui non plus puisqu’il m’interpelle : « Vous vous demandez comment cette histoire va tourner ? Voilà, cher lecteur, ce que nous ne pouvons vous dévoiler […] nous ignorons comment il finira, pourquoi même il finirait, nous en sommes au même point que vous, ou presque, puisqu’au moment où vous lisez ces lignes, notre tâche a pris fin, le livre a été publié; »
J’ai bien l’impression de me laisser mener en bateau mais tant pis, j’y reste. La prose est marrante, le narrateur parle de la société tchèque comme le modèle absolu de la connerie humaine bien cernée par lui et dont voici une des nombreuses citations « Najman était un spécimen si accompli de la connerie tchèque qu’on aurait pu l’exhiber dans les Expositions universelles : jovial, trivial, populaire, passablement inculte, imperturbable et agressif. […] Nejman excellait dans les dicussions, argumentations et opinions, de sorte qu’il jouissait de l’estime et de la considération de ses concitoyens : arriver à exprimer son crétinisme avec toute l’autorité que cela suppose est pour les Tchèques l’ambition suprême, juste après la collaboration fructueuse avec les puissances du moment et l’entretien des nains de jardin ».
Je pourrais vous citer la moitié du livre sur des phrases empreintes du style goguenard de l’auteur. Ce n’est pas non plus un gros livre et j’arrive sans peine à sa fin, avec le sentiment de m’être fait avoir comme une bleue. Arghhh.
Mais après la fin en queue de boudin, un commentaire érudit sobrement intitulé « libre suite ». C’est une explication de texte extrêmement, clairement et délicatement menée sur tous les chapitres du texte, avec notes et renvois (beurp) où il se fout encore plus de notre gueule de lecteur avide et inconséquent, avec brio, sadisme, talent et causticité. Exemple : « Le tour de force de Classé sans suite est de pousser jusqu’à l’extrême cette imposture en relançant constamment l’intérêt du lecteur par des artifices qui sont autant de promesses déçues « . S’ensuit une liste de procédés et événements qu’il nous a infligés dans ce but. Plusieurs parties dans cette dizaine de pages avec les titres en latin pour conclure que, tout flaubertien qu’il est, il a juste écrit un texte sur le rien et termine par cette affirmation interrogative : »Après tout, Kant lui-même, n’avait-il pas orné sa célèbre Critique de la raison pure (AKA III, p.233) d’une très sérieuse et, cependant d’un irrésistible effet comique, « table de la division du concept de rien « ? » Cette partie est signée d’un certain Jean Montenot qui, j’en suis sûre, n’existe même pas en rêve.
Bref, faut être tordu pour lire ce bouquin, sauf si on est dans le train avec rien d’autre qu’un vieille pie poilue en face de soi. Ou encore si on adore les exercices de style. Comme moi. Je vous aurai prévenu.
Patrick Ourednik. Classé sans suite, 2011, édition Allia. Imprimé dans l’union européenne. 176 p. 9 €
Texte © dominique cozette