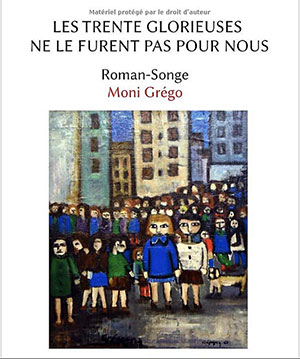Lucas Belvaux a réalisé de nombreux films dont une géniale trilogie Un couple épatant, Cavale, Après la vie qui prend la même histoire et les mêmes personnages sous un angle différent, l’un est une comédie de couple, l’autre est un polar tout a fait scotchant et le dernier un thriller psychologique. Une vraie prouesse. C’est pourquoi je n’ai pas balancé à m’offrir son premier roman Les Tourmentés, sachant d’avance que Belvaux sait construire une histoire. Et quelle histoire.
Au départ, trois personnages principaux : Skender, un type sympa qui se clochardise irrémédiablement, Max, son « frère » d’armes avec qui ils ont combattu lors de sales guerres, tué des hommes et sauvé d’autres, et Madame, richissime jeune veuve dont Max est devenu une sorte de majordome, garde du corps, confident. Cette femme à l’histoire tragique, est une chasseresse hors pair. Elle a tout chassé par delà le monde, elle manie les armes avec une précision diabolique, c’est la passion que lui a transmise son affreux mari dont on peut se demander si c’est elle qui l’a tué lors d’une chasse.
Combien vaut la vie d’un homme qui ne vaut plus rien et qui a plus ou moins abandonné sa femme formidable et ses deux fils ? C’est un contrat que se passent ces trois-là. Skender sera le gibier, Madame le chasseur et Max l’arbitre, c’est lui qui les a mis en contact. Il aura trois millions, le premier lors de l’acceptation de ce marché, le deuxième lorsque la chasse débutera, dans six mois dans une forêt de l’Europe de l’est, et le troisième un mois plus tard, à la fin de la chasse. S’il est mort, tout sera pour sa femme et ses fils. Il a le droit aussi de se défendre, sans arme bien sûr, de tuer Madame, qui, elle, est armée et aidée de ses deux féroces chiens.
Je ne divulgâche rien. Skender bénéficiera d’un logement confortable pour se préparer. Opiniâtre et toujours amoureux de sa femme, il va se refaire une santé, arrêter alcool et autres saletés, mettre au point un entraînement diabolique tandis que Max et Madame lui inventent une profession dans une multinationale qui justifie, auprès de sa femme « innocente », son nouveau look d’homme de confiance, son salaire, sa belle voiture et son retour aux bonnes manières..
Jusque là, nous apprenons à connaître les protagonistes, dont aussi l’aîné de ses fils car chaque chapitre est dit par la voix de l’un ou l’une d’eux. Nous sondons leurs pensées et assistons à l’évolution de leur mental au fur et à mesure qu’on approche du début de la chasse. Et ça devient passionnant, les personnages s’observent, s’entremêlent parfois, analysent leurs motivations, interrogent leurs valeurs.
On a envie que Belvaux fasse un film de cette histoire mais en regardant la présentation qu’il a faite de son roman, je m’aperçois que c’était d’abord un scenario. Puis c’est devenu, bizarrement, un livre. Un roman très fin, très émouvant, très profond. Avec un peu de longueur au début qu’on oublie vite.
Les Tourmentés de Lucas Belvaux, 2022 chez Alma Editeur, 344 pages, 20 €
Texte © dominique cozette