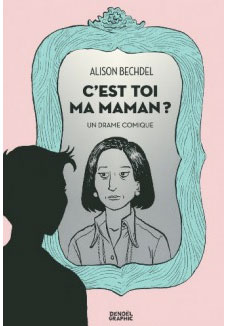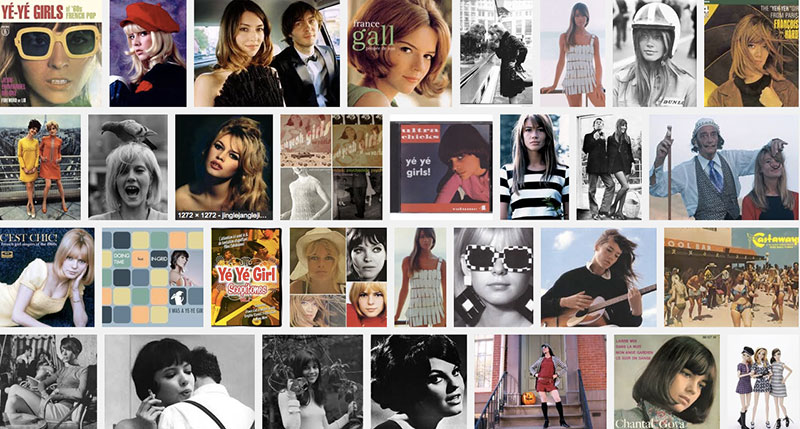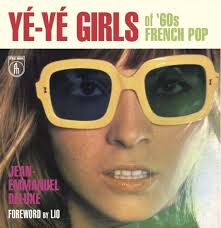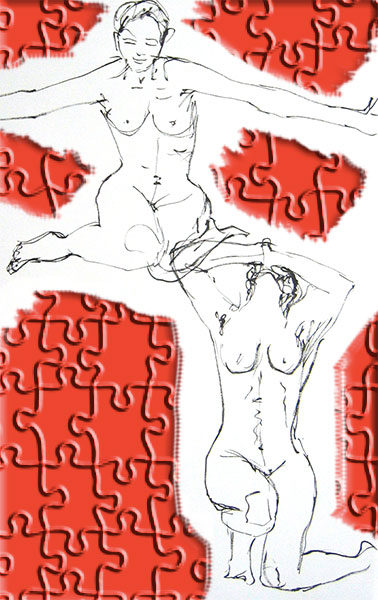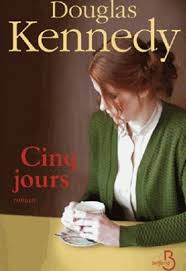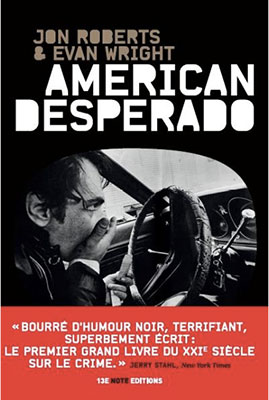
American desperado est un (enfer) pavé de mauvaises intentions de 700 pages de l’excellentissime édition 13E note, rien que ça. C’est l’histoire, même pas la confession tellement le repentir n’est pas dans la boîte à émotions, du truand trafiquant de drogue le plus célèbre des Etats Unis. Il ne s’y raconte pas à la façon des vantards mais plutôt de manière technique, comment les choses se sont tramées, les circuits se sont faites, les réseaux se sont construits. Sa vocation n’est pas venue par hasard. Jon Roberts, au vrai nom italien, est né d’un père mafioso, encadré de deux oncles de la même famille, qui délaisse sa fille — qui a bien viré — pour mieux s’occuper du moutard. Il emmène Jon partout avec lui pour régler ses affaires, la récup des rançons extorqué à ses protégés, en gros. La leçon du père : le mal est plus fort que le bien, à condition de ne pas se faire prendre, s’ancre définitivement dans la tête du mioche. Effectivement, les méfaits de son père restent impunis, même le meurtre de sang froid sur un type qui l’empêchait de franchir un pont, sous ses yeux et sans un mot d’explication. Il a 11 ans, ne moufte pas et penchera désormais pour la loi du plus fort.
Dans ce livre, ce qui est passionnant c’est qu’il donne des détails techniques pour des tas de choses : comment dresser un chien, faire couler un cadavre, trafiquer un avion ou une caisse pour que la tonne de dope qu’ils transportent soient indétectables. Jon raffole du pognon pour le pouvoir que ça donne, et il en a tellement, à un moment, qu’il l’enfouit dans des boîtes sous terre, qu’il monte des sociétés de locations de voitures ou d’autres pour le blanchir. Mais il aime encore plus être créatif dans son boulot. Trouver des solutions à tout.
Sa vie est insensée, il se tire de toutes les situations. Les plus périlleuses, même les contrats sur sa tête ne lui font pas peur. Très jeune, avec ses potes marginaux, il s’est entraîné à la douleur, à la bagarre, à l’insensibilité. Il n’aime personne et l’explique par le fait qu’il n’a jamais été aimé de son père. Mais il s’attachera à ses chiens, dont l’un d’eux, déchiqueté par un alligator, sera envoyé par hélico auprès du plus grand ponte qui le sauvera puis lui implantera des prothèses pour remplacer les crocs qu’il a perdus dans la bagarre. Il a aussi des sentiments pour ses chevaux de course, il a monté une écurie de cracks. Et il tombe même amoureux de trois ou quatre femmes, des fortes têtes dont il sent qu’elles le baiseront à mort. Car le sexe, surtout sous quaalude et coke, c’est son grand kif. Les fêtes, ce sont principalement des orgies avec du fric qui coule à flot, des putes et de la dope. En revanche, qu’un type, aussi puissant soit-il, soit pédophile, il ne le supporte pas. Une certaine morale, donc.
Son job au sein du cartel Medellin où il a beaucoup oeuvré, y est décrit avec force détails sur les façons de faire voyager des tonnes de dope, par air, terre et mer, en roulant « la concurrence ». La concurrence, c’est la police. Il est beaucoup plus malin qu’elle. Avec son acolyte Mickey, sorte de Macgyver qui apprend tout sur tout, qui sait tout construire, tout voir, tout savoir (à la longueur d’une antenne, il est capable de trouver les fréquences des garde-côtes, des flics), ils prévoient tout, le moindre problème. Ils ne cessent tous deux d’inventer des moyens imparables pour faire atterrir leurs avions (ils se servaient de bases aériennes de l’US armée), les décharger et refaire le plein en deux minutes, booster leurs performances etc. C’est passionnant. Il y raconte aussi aussi les accointances qu’il noue avec les pouvoirs aussi bien locaux que nationaux, jusqu’à la présidence.
Il se fera dénoncer par le bras droit d’Escobar, pour lequel il bosse, un gros mou peureux et ridicule mais intouchable, qui a lâché son nom pour alléger sa peine. Mais il est blindé, il a de très bons avocats, il a su fractionner ses unités de travail. Pour alléger sa peine de 300 ans de tôle, il promet de livrer Mickey. Ce qu’il ne fera pas. Il ne fait que trois ans, même lui trouve que c’est immoral. Et ces trois ans lui font découvrir le manque… pas de dope mais d’amour. Il aime sa dernière femme mais surtout son gamin dont il s’est beaucoup occupé seul, qui est devenu son objet d’amour et auquel il essaiera de donner une bonne éducation. Son fric s’est évaporé, il n’a plus rien mais le boulot ne lui fait pas peur, il tente de mener une vie normale.
Il a écrit ce bouquin avec un excellent journaliste. C’est très bien fait, sans pathos, avec une sorte d’humour noir et de détachement incongru qui fait que ce type — qui est quand même une ordure et ne s’en défend pas — montre des côtés plutôt sympathiques.
Il est mort juste après la sortie du livre, en 2011. Il avait 65 ans, ce qui n’est pas mal vu la vie qu’il a menée et surtout les kilos de dope et d’alcool qu’il a ingurgités. J’ai fait l’impasse sur l’enfer du Vietnam où il s’est engagé pour effacer son casier de jeune délinquant, les boîtes de nuit qu’il a « tenues » à Miami, les anecdotes sur les people, qu’il méprise totalement, ou les puissants. Beaucoup de films ont été inspirés par ses multiples aventures.
American Desperado de Jon Roberts et Evan Wright chez 13E note Editions en 2011, 2013 pour la France. 702 p. 25,95 €.