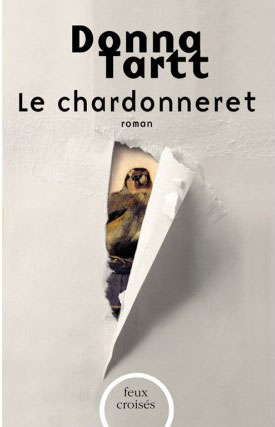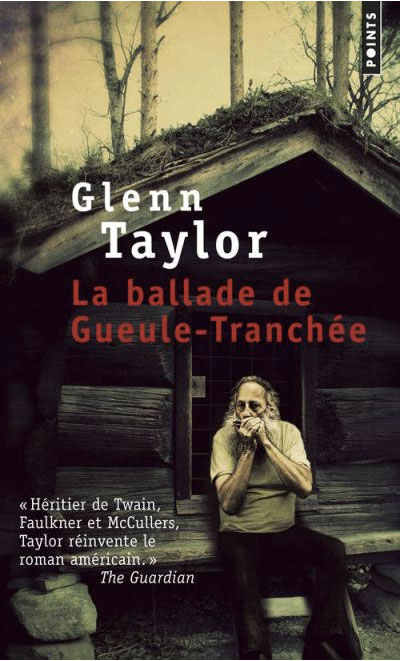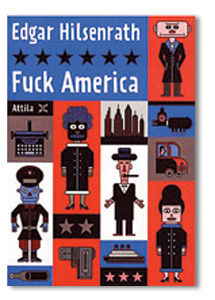
C’est un migrant juif allemand, ayant connu les affres du ghetto et de la shoah, qui titre ainsi son bouquin. Il s’appelle Edgar Hilsenrath et raconte, dans une transcription burlesque, l’épopée de son double : Jakob Bronsky, pauvre petit émigré juif, pitoyable, passé par l’Europe et vivant dans les bas-fonds new-yorkais.
Il loue une chambre chez une logeuse et ne songe qu’à la première ligne du livre qu’il va écrire. Pas question de travailler « normalement », il ne fait que des extras pourris que lui fournit un bureau de placement pour clodos. Les clodos sont ses copains, et quand il peut, il s’offre une pute mais c’est jamais brillant. Son sexe le taraude, le fait souffrir, s’érigeant facilement mais sans rien pour le calmer, car il ne se masturbe pas. Les douches froides, ça ne marche pas toujours et même avec des vieilles putes hors d’âge, il éjacule trop vite. l’enfer. Les femmes blanches, c’est même pas la peine d’y penser. Le rêve américain n’est pas pour lui.
Il arnaque pas mal, vole, triche aussi pour survivre, comme il avait dû le faire dans le ghetto et lors de ses errances tragiques pendant la guerre. Et quand vraiment il n’a plus un fléchard, il bosse une nuit, pas plus. Une vraie feignasse.
Pourtant, même si c’est en partie autobiographique, le roman n’est jamais dramatique. Il a le chic du recul et de la mise en abyme, de la dérision, de la fantasmagorie. Ses dialogues sont brefs et répétitifs, comme des petits poèmes absurdes, ses préoccupations sont simples. Et lorsqu’il rêve de réussite ou d’une belle scène de cul avec une secrétaire de direction, il le décrit comme si ça arrivait. Tout ça, assez crument.
Ce livre qu’il rédige en allemand, il mettra du temps à le publier mais, en vrai et sur le tard, il y parviendra. Il en écrit deux ou trois autres, ayant tous pour thème ses tribulations. Entre Art Spiegelman pour la dédramatisation et Woody Allen pour la lose, Edgar Hilsenrath, sorte de clochard céleste, a trouvé une façon originale de raconter sa Shoah et ses dégâts collatéraux.
Interview ici en allemand de ce clochard céleste.
Fuck America par Edgar Hilsenrath aux éditions Attila. VO en 1980, VF en 2009. 296 pages. 19 €. (voir en poche, peut-être…)
Texte © dominique cozette