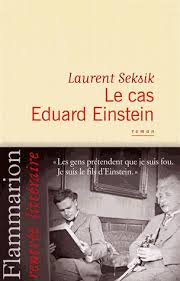
Le cas Eduard Einstein, le dernier livre de Laurent Seksik, raconte le destin tragique de cette famille décomposée que le patriarche, Albert, n’a pas réussi à construire. Tout jeune étudiant, Albert tombe amoureux d’une étudiante fragile qui boîte un peu mais qui l’attendrit. Bien plus tard, ses biographes apprendront qu’ils ont eu une fillette, morte très jeune, cachée de tous, secrète et non avenue dans l’historique du grand homme. Puis deux fils dont l’un, Eduard, a finalement peu ou prou le statut de sa soeurette inconnue : abandonné, nié.
Monsieur Einstein, grand homme mais aussi séducteur incorrigible, se sépare de sa femme et de ses fils pour vivre une autre histoire. La chasse aux Juifs de ce temps-là le fera émigrer vers les Etats-Unis où il n’est pas vraiment le bienvenu. C’est la chasse aux sorcières, on le prend pour un communiste, et le fait qu’il ait inventé la bombe qu’il va pourtant tenter de stopper, ne plaide pas en sa faveur.
Pendant ce temps, sa femme, qui a renoncé à sa carrière pour lui et pour élever ses enfants, se débat avec Eduard dont on a découvert à 18 ans la schizophrénie. Jamais remise d’avoir abandonné sa fillette qui est morte loin d’elle, elle se concentre sur les soins à donner au fils malade.
Electrochocs, séjours en instituts spécialisée, tentatives de suicides et auto-mutilations lui interdisent toute tentative d’insertion dans une vie normale.
La mère perdra la tête avant de mourir, le grand-frère exilé lui aussi aux Etats-Unis, ne pardonnera que très tard à son père d’avoir bousillé leurs vies. Et Albert ne pourra jamais — jamais — se résoudre à revoir cet enfant-boulet dont il impute le handicap à sa belle-famille. C’est son drame, il est incapable d’y faire face et ne peut, de l’autre côté des mers, qu’envoyer de l’argent pour que d’autres s’en occupent à sa place.
L’intérêt du livre, outre l’histoire elle-même, est la façon dont elle est racontée, sous trois points de vue. Celui du père, celui de la mère mais surtout celui-du « je », Eduard lui-même, qui se met à nu. Oh oui, il est conscient que quelque chose débloque chez lui, mais sans en être convaincu. Il n’aime pas son père. Il supporte très mal le nom d’Einstein, si lourd à porter, et qu’il s’autorise si peu à investir. Il nous émeut par son désarroi, ses incohérences, ses amitiés fugaces, son attachement à sa mère, et finalement, sa résignation au sort que la vie lui a réservé.
Le cas Eduard Einstein, de Laurent Seksik chez Flammarion, 2013. 300 pages, 19 €.
Texte © dominique cozette
