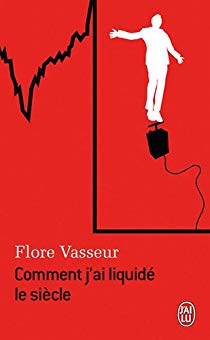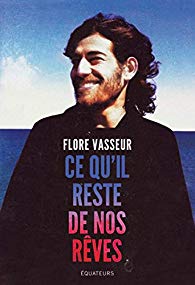Bon, tout le monde ne connaît pas Edouard Levé, plasticien très intéressant en même temps que très tourmenté, qui s’est pendu en 2007 à 42 ans alors qu’il venait de remettre son dernier livre, Suicide, une fiction, à son éditeur. Le principal medium de Levé était la photo grâce à laquelle il reproduisait des scènes de la vie : ses rêves remis en scène avec les vrais personnes qu’il se donnait le mal de retrouver, des scènes pornographiques (nues) refaites avec des personnes joliment vêtues, pareil pour Rugby — je pense que la photo de couverture du livre fait partie de cette série — des portraits de gens (de la campagne souvent) s’appelant Marcel Camus, ou je ne sais plus qui de très célèbre… Et il écrivit quelques livres magistraux, l’Oeuvre qui listait toutes ses idées créatives en trois lignes, Autoportrait qui tissait sa biographies en courtes phrases sans rapport les unes avec les autres.
C’est par Martine Camillieri (merci Martine !) que je l’ai connu, lorsqu’elle l’a exposé dans sa galerie la Périphérie, à Montrouge : j’ai été tout de suite séduite par son travail. Et tellement orpheline lorsqu’il est mort !
Bruno Gibert, l’auteur de les Forçats, a connu Ed en visitant ce qui lui tenait lieu d’atelier, son studio miteux, où il avait peint un tableau monochrome fait avec sa merde et qu’il avait laissé sécher sur le balcon des mois. Amis depuis ce temps, ils cherchaient chacun comment développer leur notoriété artistique, comment s’imposer dans ce vaste domaine, comment mettre leurs idées en pratique. Ils s’amusaient, buvaient, draguaient, papotaient des nuis entières mais ne foutaient pas grand chose bien qu’ils fussent tous deux diplômés dans des disciplines sérieuses.
Bruno Gibert raconte surtout des anecdotes, des flashes de souvenirs, pas forcément sur Ed mais beaucoup quand même. Ed se sentait à l’écart des choses, loin de la vraie vie d’artiste. Il était peut-être un peu snob. Lorsqu’il a réussi à vivre dans le marais, il était content d’y croiser des people, d’aller saluer du monde aux vernissages, de se faire connaître. Mais pouvait aussi disparaître des jours entiers. Puis une galerie, Loevenbruck je suppose, l’a lancé et il a vite fait partie de la jeune scène artistique qui compte. Mais il était mal à l’aise, ne savait pas parler aux enfants, ne comprenait pas ce qu’était l’amour et comment on pouvait vivre ensemble dans le mariage. Car Bruno Michel était non seulement marié, mais il avait une enfant et un vrai travail. Donc leurs routes s’étaient éloignées.
Difficile de résumer ce style de livre, ce n’est pas un roman, ni un éloge de l’ami disparu ni une sorte de bio de l’auteur, plutôt une petit vademecum sur comment on pouvait devenir artiste conceptuel (ou pas) à l’aube du nouveau millénaire.
En tout cas, très instructif et intéressant !
Les forçats de Bruno Gibert, 2019 aux éditions de l’Olivier. 154 pages, 16 €
Texte © dominique cozette