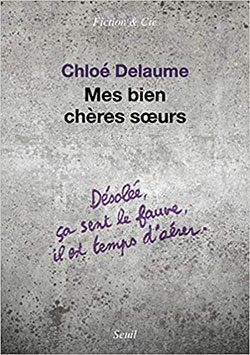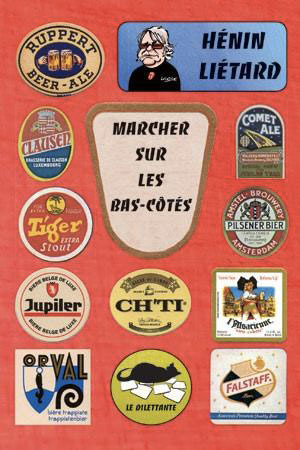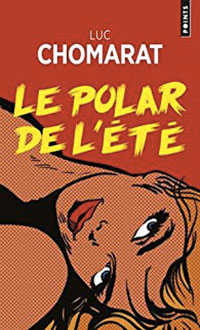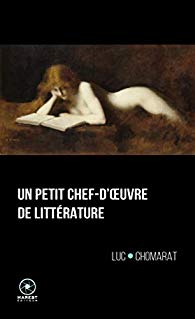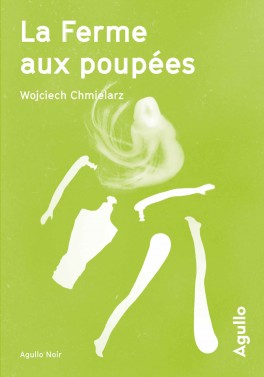Tiens ferme ta couronne, drôle de titre pour ce livre hypnotique de Yannick Haenel. Moi qui n’aime que les histoires concrètes et plutôt réalistes, je suis tombée dans une sorte de fascination pour cette histoire époustouflante d’un héros tout ce qu’il y a d’ordinaire. Imaginez : un quinquagénaire qui s’abrutit devant des films de Cimino, notamment le voyage au bout de l’enfer (the deer hunter) en se saoulant de vodka sans pratiquement sortir de son studio. Parfois, il s’occupe du dalmatien du voisin, un joueur de poker invétéré, qu’il n’a pas vu depuis des jours, présentement. Ce reclus fumeur et asocial, Jean, a écrit un pavé sur Melville, the Great Melville, un scénario impossible à mettre en images mais dont il espère que Cimino saura le faire. Il rencontre une sorte de personnage improbable qui lui donne le numéro du réalisateur. Jean n’y croit pas. Il appelle malgré tout et tombe sur … Cimino, ravi d’avoir un admirateur et amateur de Melville, comme lui. Jean embarque alors pour New-York et vit une drôle d’aventure avec le réalisateur. Quelques mois plus tard, l’intermédiaire le recontacte pour savoir où ça en est, lui donne rendez-vous chez Bofinger (grande brasserie à la Bastille) et là, ils se saoulent et invitent Isabelle Huppert à leur table (elle connaît le type). S’ensuit le récit de Jean entrecroisé de celui d’Huppert qui a joué dans un Cimino en 79, etc…
C’est absolument insensé la façon que l’auteur a de raconter une histoire aussi bancale à base de cerfs, de daims, de chien perdu, de dette de jeu, de poursuite de mots, de quête d’une vérité sacrée. Sans parler d’une nuit passée au Musée de la Chasse et de la Nature avec des tas d’animaux et la directrice du lieu, femme très ouverte… Le lendemain, Jean se retrouve dans une mélasse absolue mais on a tellement envie de savoir ce qu’il va devenir. C’est totalement rocambolesque et captivant et d’une grande culture cinéma et littérature.
Tiens ferme ta couronne de Yannick Haenel, prix Médicis 2017 aux éditions Gallimard et Folio. 360 pages.
Texte © dominique cozette