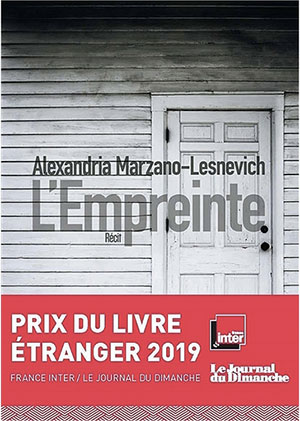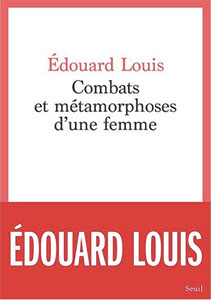Robert Goolrick, dont je suis devenue fana tout récemment,raconte, dans La Chute des Princes, la vie de folie, fric, alcool, drogues, sexe, puis la chute, dans les années 80, ces fameuses années déjà racontées et filmées par d’autres, mais c’est pas parce que Roméo et Juliette a déjà été narré qu’on ne doit plus parler d’amours contrariées. Ici, l’important c’est le style, formidable, et la qualité des anecdotes, incroyables. Je les ai un peu évoquées dans le dernier livre Ainsi passe la gloire du monde (voir ici), qu’il faudrait lire après celui-ci, mais peu importe. Quand on aime un auteur pour sa qualité d’écriture, rien n’est grave.
Ce qu’il raconte, c’est la gloire d’un trader, ces mecs qui faisaient des fortunes colossales sur le marché des bourse. Mais pour lui, l’auteur, c’était en fait d’âge d’or des années fric de la pub. Pareil, des monceaux de pognon qu’on claque pour rien, juste parce qu’on l’a gagné en travaillant parfois trois jours sans nuit, avec la coke of course, et surtout la fierté de surenchérir, d’en faire encore plus que les collègues. Le plus est le mieux. Les vanités de cette époque.
Evidemment, il y a des dommages collatéraux. Il tire avec brio le portrait d’un richissime collègue, fortune de famille gigantesque, indépensable, un type formidable aimé de tous, des délires de vacances, etc puis un jour, après un coup de fil personnel, au bureau, après avoir brisé la vitre avec un extincteur, ce qui a tué deux personnes en bas, il retire ses chaussures (les chaussures sont toujours de marque et hyper précieuses) puis saute du gratte-ciel, et s’écrase sur une voiture. Il venait d’apprendre qu’il était atteint de cette terrible maladie appelée sida, ce qui était moins grave que la honte insurmontable qui éclabousserait ses parents, homophobes pure souche. Ils l’ont d’ailleurs effacé de tous les documents familiaux, photos, souvenirs. L’auteur s’inquiète vaguement pour lui-même car il baise tout ce qui bouge, hommes et femmes. Mais il s’en sort sans une égratignure.
Il parle aussi de cette pute, un travelo magnifique, avec qui il est devenu ami, car, malgré un loft magnifique créé par le plus grand décorateur, il a gardé son taudis infesté de bestioles, dans le quartier pourri où sévissent tous les crimes. Donc les prostitués, dealers et clients. Sa femme, il l’aime toujours bien qu’elle l’ait quitté le jour où il a perdu son job. Il lui a tout laissé sans discuter, sauf le taudis.
Il raconte beaucoup d’excès, avec humour et non sans cynisme. Comment il a eu son job juteux : le patron de la Firme recrutait ses traders au poker. Une seule et courte partie. Car dans ce type de boulot, il faut savoir prendre des risques énormes. Il dit comment ça a fini, piteusement, violemment, et comment, quand on est viré, personne n’est plus censé vous parler, vous téléphoner, vous connaître. Monde impitoyable.
Et là, comme dans le dernier livre, il se retrouve à claquer ses derniers deniers, avec panache, avant de se fondre dans une solitude plutôt bien subie. Je pourrais en dire plus mais ça me fatigue et puis je suppose que vous voyez le genre de livre que c’est. Brillantissime. C’est dit.
La Chute des Princes ( The fall of princes, 2014) de Robert Goolrick chez 10/18. 240 pages.