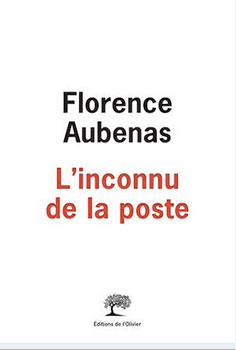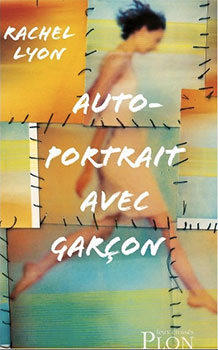
Auto-portrait avec garçon est le premier livre (et quel livre !) de Rachel Lyon. On est dans les années 90 à New-York. Lu Rile est une jeune photographe sans argent et squatte, comme quelques autres artistes, un ancien entrepôt complètement pourri qui deviendra, plus tard avec la gentrification, un superbe loft. En attendant, il y fait très froid, on dort couvert de plusieurs couches de vêtements, ça pue, il y a des rats, pas souvent de l’eau chaude et il semble qu’un acheteur fasse tout pour virer les occupants, même s’ils paient un loyer. Les photos de Lu sont celles qu’elle glane en se promenant, son précieux Rollei autour du cou mais elle réalise aussi une série d’autoportraits dans des mises en scène imaginatives. Le dernier va changer sa vie : elle se photographie en petite tenue en train de sauter devant la baie de son loft. Le résultat ne sera visible qu’au tirage. En fait, en fond, derrière la vitre, un enfant tombe du ciel. Il s’agit du fils des voisins du quatrième, tombé accidentellement du toit terrasse lors d’une fête. C’est une photo extraordinaire, tétanisante. Un chef d’œuvre. Mais faut-il exposer une telle photo face à la douleur des parents endeuillés de leur enfant, qui plus est voisins et dont la femme deviendra son amie ? Peut-on devenir une artiste reconnue en trahissant les siens ? Rester dans l’ombre en détruisant ce cliché ? C’est tout le dilemme de Lu.
En dehors de cette question cruciale qui tient en haleine, Lu nous entraîne dans la visite de la vie à New-York quand on est complètement fauché, quand personne ne peut vous aider, quand il faut exercer trois boulots de merde pour subvenir à peine à ses besoins. Lu est une jeune femme assez insignifiante, petite, avec de grosses lunettes, n’imprimant pas les esprits, se sentant mal à l’aise dans les groupes de gens, les expos.
Pour aller aider son père en train de devenir aveugle, elle emprunte la bagnole pourrie de potes. Il vit sur la côte dans un coin médiocre et une maison inconfortable. Elle cherche (comme dans les derniers livres américains que j’ai lus, bizarrement) des traces de sa mère dans le fourbi du garage où son père a accumulé des tas de saletés, mais rien. Une opération est nécessaire sur les yeux de son père mais il n’a pas un radis et elle encore obligée de s’y coller…
Voir cette petite bonne femme naïve et frêle se débattre dans un bain de problèmes n’est pas d’une gaité folle mais c’est un super bon livre. D’ailleurs, quand je vois la liste des personnes remerciées à la fin, je trouve que les nouveaux livres ressemblent plus à des entreprises de travaux publiques que l’œuvre en solitaire d’un auteur. Mais qu’importe, le résultat en vaut la peine. Un pavé bien construit qu’on a du mal à interrompre.
Autoportrait avec garçon (Self-portrait with boy 2018) de Rachel Lyon. Traduit par Jérôme Schmidt. 2019 aux éditions Plon. 450 pages, 23 €.