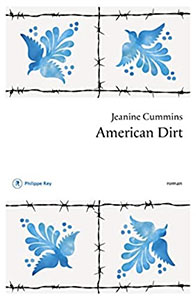Retour à Martha’s Vineyard de Richard Russo jouit d’une critique très élogieuse. Pour tout vous dire, je l’ai trouvé un peu longuet parce que Russo, comme à son habitude, décrit dans leurs détails les plus insignifiants la bio des héros qu’il accompagne, de leurs parents, grands-parents, antécédents divers, scolarité, rencontres. Je ne dis pas que ce n’est pas passionnant mais parfois on a envie d’aller au cœur du sujet sans tous ces détours. Imaginez qu’un pote vous dise « je t’emmène dans un super resto ouvert et autorisé, c’est un peu loin, mais on y va », et qu’au lieu de prendre autoroute ou nationales, votre ami préfère vous embarquer dans de sinueuses petites routes de traverse, s’arrête parfois pour vous faire renifler un rameau de mimosa ou vous abreuver à une source divinement fraîche. Puis vous arrivez à mi-chemin, vous avez même la sensation que votre ami, tenaillé par la gourmandise (il vous décrit quelques amuse-bouche) décide d’entrer plus directement dans le vif de l’affaire, mais non ! Il continue à vous balader de vallons en guérets, de sentes en collines… Puis au loin, vous apercevez une folle bâtisse, il vous dit c’est là-bas. Mais… patience, pas encore, jamais directement. Enfin la récompense ! Et vous le remerciez de vous avoir trimballée car ça valait le coup … de fourchette.
L’histoire : ils étaient trois potes plus une nana, Jacy, dans les 70’s, soudés dans ce modeste campus où ils étudiaient. Les trois étaient follement amoureux de cette fille libre qui montrait peu d’intérêt pour son fiancé genre coincé. Pour fêter leur diplôme et surtout faire une dernière fête avant le départ au Vietnam de certains, ils passent un week-end dans cet endroit mythique, dans une belle baraque appartenant à la mère de l’un d’eux. Puis ils se séparent, se perdent de vue, ayant vaguement des nouvelles les uns des autres sauf de Jacy qui a disparu corps et bien après avoir quitté l’île. Ni ses parents, ni ses amis ou son fiancé n’ont su ce qu’il était advenu de cette fille formidable. Grosse blessure jamais refermée pour nos héros.
Quarante ans plus tard, l’héritier de la maison décide de la vendre, ce qui leur donne prétexte à se réunir ici pour quelques jours, comme au bon vieux temps. Ils ont 66 ans, plus ou moins réussi, sont un peu abîmés par l’âge mais croient au retour de leur belle jeunesse dans ce cadre idyllique. Cependant, le vide inquiétant laissé par Jacy devient de plus en plus encombrant. Des anecdotes remontent à la surface, un voisin style prédateur est soupçonné de l’avoir tuée, un vieux flic est approché… Peu à peu, on se rapproche de ce qui est arrivé. Et ce n’est pas rien. C’est même étonnant. Bref, ça valait le coup … de fourchette !
Retour à Martha’s Vineyard de Richard Russo. 2019. Chances are… titre original. Traduit pas Jean Esch. Aux éditions Quai Voltaire. 380 pages.
Texte © dominique cozette