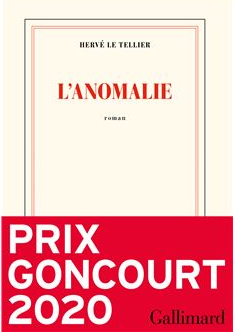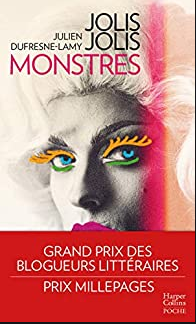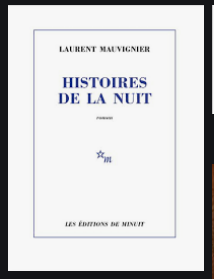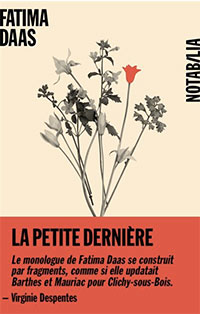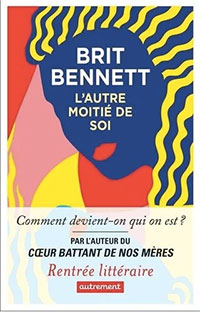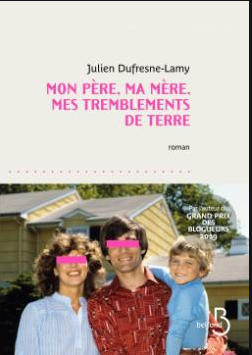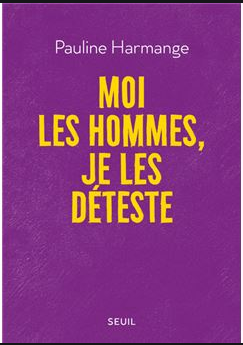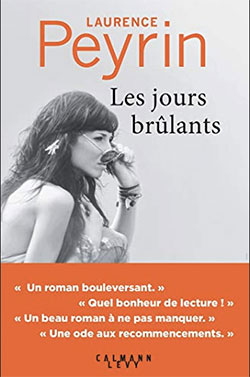
Comme disent certain.e.s, les Jours brûlants, de Laurence Peyrin, n’est pas le genre de littérature que je lis, bon, mais c’est quand même bien écrit et l’histoire est prenante, à lire plutôt allongée sur une plage si vous avez les moyens d’aller dans les îles. Bizarrement, c’est une Française qui écrit ce roman très américain. Il faut dire qu’elle a vécu là-bas et tout ce qu’elle décrit et cite, avec précision semble-t-il, ne sort pas de son imagination.
C’est donc un roman qui nous expose — classiquement à l’américaine — le cadre d’une petite bourgade californienne où vit une famille très unie, parfaite, avec un mari super beau qui gagne bien sa vie, une femme très belle qui a fait le choix de s’occuper de son foyer, ils sont toujours très amoureux et épanouis. Leur fille est féministe et engagée, elle fustige sa mère pour sa médiocrité intellectuelle, leur garçon plus jeune et sympa. Tout roule, ils ont des amis, des beaux endroits où passer les vacances, tout est parfait jusqu’au jour où elle est sauvagement agressée par un junkie qui lui pique son sac en l’injuriant.
D’un coup, une porte s’ouvre sur l’enfer, la société hideuse dont elle n’a jamais rien su, la mocheté du monde, et peu à peu, malgré l’aide que lui proposent son mari et son amie, aide qu’elle refuse, tout se déglingue en elle. Elle adopte des comportements plus que bizarres, se sent glisser vers l’abjection jusqu’à devenir une moins que rien.
Alors elle décide, pour le bien de sa famille, de disparaître. Elle laisse tout, même son alliance, son chéquier (en est dans les 70’s, pas de CB ni de portables) et va au hasard à bord de sa petite voiture pourrie. Le hasard l’amène à Las Vegas où, sans le sou, elle commence sa nouvelle vie en dormant dans sa voiture et tentant de rester propre et présentable. Une fois encore, on lui vole son sac et le peu qu’il contenait, les papiers et le permis, surtout. Et alors, miracle de la vie, une gentille main se tend, qui va l’entraîner dans une sorte de refuge pour filles perdues. C’est ici qu’llle entreprend sa reconstruction. Mais est-ce si facile de fermer sa mémoire et de tout laisser derrière soi ?
C’est une histoire bien écrite, bien structurée qui nous attire vers cette drôle de vie que Joanna partage avec des drôles de nanas, strip-teaseuses, junkies, fugitives, dans cet enfer qu’est Las Vegas quand on n’y vient pas pour jouer, se marier ou enterrer sa vie de garçon.
En tout cas, personnellement, ça m’a bien distraite.
les Jours brûlants de Laurence Peyrin, 2020, aux éditions Calmann Lévy. 430 pages, 20,50 €.
Texte © dominique cozette