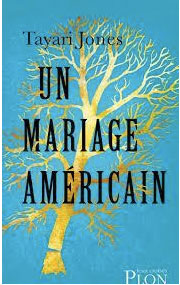Betty est le nom de l’héroïne et narratrice dans le roman éponyme, écrit par Tiffany McDaniel (qui mit plus de quinze ans à trouver un éditeur). Comme quoi, bon. Aujourd’hui, c’est un succès international et vous le verrez en piles chez votre libraire. Car c’est une histoire aussi attachante qu’originale. Betty, nous allons d’abord suivre ses parents avant de la connaître. Lui, c’est un indien cherokee, autant dire un mulâtre en butte au racisme et au mépris de classe. Sa mère est blanche. Ils ont tiré un coup, elle s’est retrouvée enceinte et comme elle détestait ses parents, elle s’enfuit avec cet homme bon et droit après avoir corrigé le père pour lui apprendre à frapper sa fille. Ils deviennent des itinérants, précaires, adeptes de petits boulots et à chaque état traversé, font un nouvel enfant. L’aîné s’en tire bien, mais deux autres petits ne vivent pas longtemps. Viennent ensuite trois sœurs qui s’entendent et qui s’aiment, puis des petits frères, mignons. Entre temps, la famille s’est établie dans une grande vieille maison vétuste qu’on dit maudite. Pour nourrir (mal) sa famille, le père fait ce que ses ancêtres lui ont appris : tout. Des médecines à base de plantes, des boissons alcoolisées, des meubles, des sculptures. Mais surtout, des légendes qu’il invente ou transmet, on ne sait pas. Tout lui inspire de belles histoires qui enjolivent leur vie assez rude, qui consolent de bien des tracas, qui donnent force à ses petits, surtout à sa « petite indienne », Betty, qui lui ressemble tellement. Il veut lui rendre ce qu’on a pris à leur culture : la puissance féminine. Car chez eux, jadis, ce sont les femmes qui dominaient tout. C’était une société matriarcale.
Donc, de bien avant sa naissance jusqu’à ses 19 ans, Betty raconte leur vie, raconte ses complexes liés à sa couleur de peau, alors que ses sœurs sont plus blanches, le harcèlement dont tous les enfants de sa classe font preuve à son égard, même les enseignants qui n’ont aucune pitié. Elle raconte aussi comment la nature lui donne du plaisir. Mais tout n’est pas rose. La vie de la famille est semée de drames, il y aura des violences innommables, des morts dont celui de son petit frère par sa faute.
Et pourtant ce livre est d’une grande tendresse et d’une grande poésie. Le mérite en revient à cet homme, ce père aimant et tellement à l’écoute de tous, un homme qui gomme le mal de toute chose, qui sait toujours ce qu’il faut faire pour atténuer le moindre problème, comme les grands drames. Il nous parle du secret des plantes, des oiseaux, des insectes, des étoiles : la seule chose qu’il a su compter dans sa vie c’est le nombre exact d’étoiles à la naissance de chacun de ses enfants.
Parfois, j’avoue que j’ai lu un peu en diagonale quand les herbes et les arbres prenaient leur temps pour exister dans le livre, j’avais juste envie de savoir ce qui allait arriver à nos personnages. Peut-être ne suis-je pas toujours assez fleur bleue ! Mais une fois le livre fini, sur un dénouement aussi profond qu’inattendu , on a peine à se séparer de la petite Betty à laquelle on ne peut s’empêcher de s’attacher.
A noter que Betty est le nom de la mère de l’autrice qui était elle-même fille d’une mère blanche et d’un père cherokee.
Betty de Tiffany McDaniel, 2020, aux éditions Gallmeister. Traduit par François Happe. 720 pages, 20,40 €
Texte © dominique cozette.