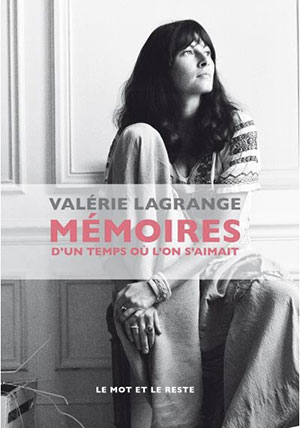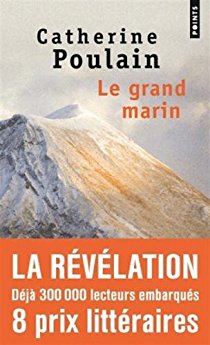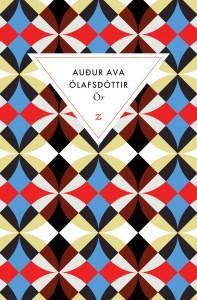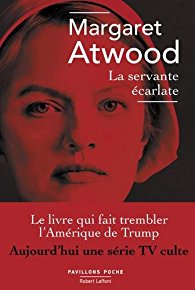Si vous ne connaissez pas Babouillec, vous ne me croirez pas. Son portrait ici. C’est une autiste profonde qui n’a jamais appris à lire, à écrire, à parler mais qui possède un cerveau somptueux. Elle retient tout, s’intéresse à tout, écrit comme personne avec un vocabulaire insensé. Chacune de ses phrases est une lumière dans une explosion d’artifice, c’est interrogeant, ça demande une attention pour ne rien rater car tout est important, ou interpellant, ou philosophique dans Rouge de soi. Comme dans Algorithme éponyme et autres textes son premier opus.
Il faut savoir qu’elle « écrit » en déposant des petites lettres en carton sur une feuille et c’est sa mère qui transcrit tel quel. Pas une seule faute d’orthographe, jamais. Des litanies superbes, des pensées magnifiques.
C’est un roman, l’héroïne s’appelle Héloïse Othello, elle est danseuse et participe à des ateliers de créations. Elle a deux chères amies plus le frère de l’une d’elles, en sus, pour le fantasme. Elle a aussi une réparatrice de vie, madame Sanchez (jeu de mot ?) qui la remet sur des rails. C’est pas qu’elle veut être comme tout le monde, avec son cerveau qui ne se plie pas aux règles sociétales, bien au contraire, elle attache une grande importance à la différence mais cherche le minimum de confort pour pouvoir communiquer.
Héloïse, qui jouit de l’autonomie de son corps ce qui n’est pas le cas de Babouillec, est néanmoins sa projection. Elle aussi écrit son livre qui va s’appeler Rouge de soi. Elle explique : « rouge comme les interdits, le sang, l’intimité, l’émotion suprême, la timidité, le dépassement de soi dans la profondeur de l’identité, le carrefour des sens interdits. »
A lire absolument si vous êtes amoureuse/reux des mots, des questions philosophique, du vocabulaire. C’est l’éloge de la différence ou comment faire d’un enfermement terrifiant la zone de décollage d’une poésie hallucinante !

Quelques citations d’Hélène Nicolas, alias Babouillec :
« La définition du mot plaisir oriente notre vision du plaisir : fournir du désir à nos intentions. La vie occupée à décrypter les intentions polymorphes de ses hôtes ignore la routine. »
« La liberté d’opinion est un acte précieux inscrit dans la charte des droits de l’homme. A-t-on le droit de s’en servir lorsque nos opinions froissent notre famille, doit-on élire à l’unanimité les opinions permises ? »
« Ma soeur, c’est la nana qui aimerait squatter votre subconscient pour écrire votre histoire avec ses idées. Elle fait partie des gens qui prennent beaucoup de place. Elle ne sait pas où loger son « elle », alors elle déborde. »
» Suzy la femme a la générosité sauvage d’un cerveau sans garde-fou. Elle a laissé entrer Héloïse et ses valises remplies d’inconvenances dans la démesure. Suzy, cette raccommodeuse d’esprits effilochés, aide son amie à rassembler les morceaux rouges de soi ».
« Je me suis battue en dehors des conventions sociales qui véhiculent des modèles indéchiffrables dans ma panoplies sensorielle, ce vaste monde de l’auto-construction et je me suis construite dans cet indéchiffrable surréalisme de la pensée, cet ailleurs tellement loin de l’hypothèse du bébé parfait. Combien sommes-nous dans ce monde réglementé à dérailler dès la naissance et à ne jamais trouver la bonne bicyclette ? »
Et la plus belle :
« Avec l’écriture, j’ai enfin trouvé un moyen de me raconter sans parler de moi. »
Epoustouflante, je vous dis !
Rouge de soi de Babouillec, 2017 aux éditions Rivage. 142 pages. 15 €
Texte © dominique cozette