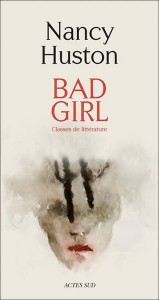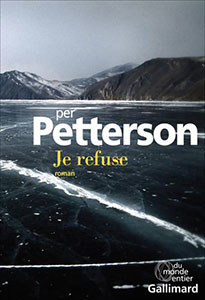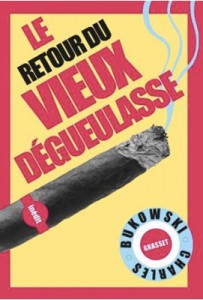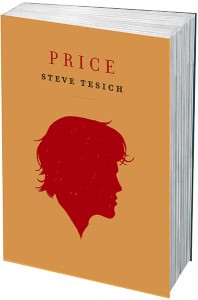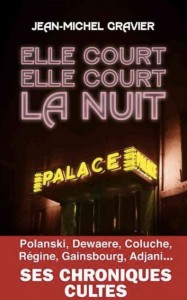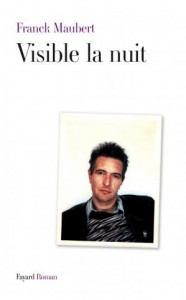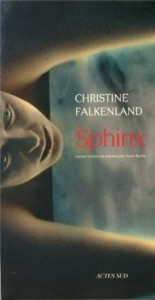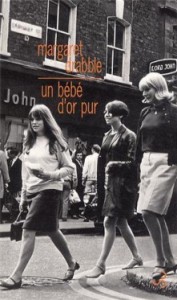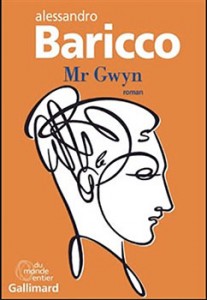
J’ai eu le bonheur de voir Novecento au Rond-Point, mis en scène et raconté de façon formidable par l’immense André Dussolier, sur le texte de Baricco, très belle histoire d’un pianiste et d’un bateau. Ça m’a donné une envie furieuse de lire d’autres histoires de Baricco dont j’avais adoré Soie en son temps
Mr Gwyn est sorti en français cette année et c’est une histoire bien étrange, bizarre, décalée, qui excite la curiosité : Saura-t-on ce qu’on brûle de découvrir à la fin du roman ? Mystère.
Mr Gwyn est un écrivain à la mode qui fait paraître un article dans The Guardian dans lequel il s’engage à ne plus faire 52 choses, dont certaines assez drôles comme se tenir le menton avec la main pour se faire photographier, être poli avec des collègues méprisants, écrire de nouveaux articles dans le Guardian. La plus importante étant : écrire des livres.
Son agent, se voyant mal privé de sa manne, lui objecte qu’aucun écrivain n’a réussi à s’empêcher d’écrire. Mais Mr Gwyn est têtu. Cependant, le temps passant, ça le travaille, il commence à ressentir le manque jusqu’à ce qu’un portrait dans une galerie lui donne une idée : devenir copiste. « Copier » les gens. Copier ? Oui, faire un portrait écrit mais surtout pas une description.
Pour exécuter cette tâche, il met en œuvre un rituel : il trouve un lieu joliment décati, le meuble très sommairement et surtout, fait fabriquer un certain nombres d’ampoules qui doivent créer un éclairage enfantin, puis s’éteindre presque ensemble au bout d’un mois. Le temps de réaliser le portrait.
La première personne qu’il prend comme modèle, contre rémunération, est une jeune employée de son agent, potelée, pas spécialement jolie. Il lui donne la clé de l’atelier et lui demande d’être là, nue, quatre heures par jour. Constatant qu’il a réussi cette gageure, il fera neuf portraits, chacun délivré aux commanditaires en un seul exemplaire, sous forme de grandes feuilles manuscrites, avec ordre de ne jamais en parler sous peine de poursuites importantes.
Ce livre est un régal car il fourmille de détails intrigants, saugrenus, bizarroïdes. Et on se demande comment se présentent réellement ces portraits, mais aussi ce qu’est devenu Mr Gwyn, ce que cherche également la jeune modèle dans ses pérégrinations londoniennes.
Mr Gwyn d’Alessandro Baricco, 2011. Traduit de l’italien par Lise Caillat aux éditions Gallimard Du monde entier, 2014. 184 p., 18,50 €.