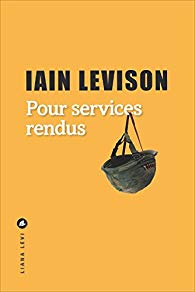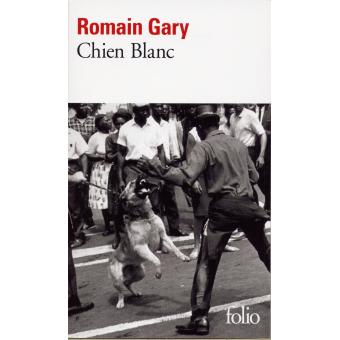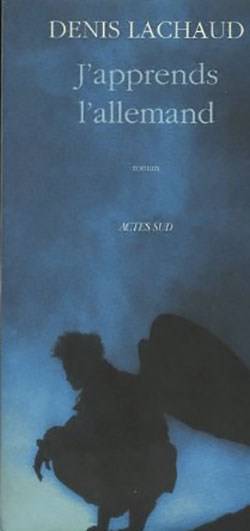Il s’appelle Augustin Burroughs mais n’est pas de la famille de William. Courir avec des ciseaux est un « récit autobiographique » comme écrit en petit sur la couverture de l’édition du Marais. Quelle drôle de vie ! Complètement décousue, trash, bizarroïde, déjantée, sans l’once d’une éducation bourgeoise. Son père est un prof de maths alcoolo et sa mère une poétesse psychotique qui s’est fixée sur un psychiatre chez qui elle passe la plupart de son temps. Le garçon adore tout ce qui brille, il aime être nickel, lisser ses cheveux, astiquer les pièces de monnaie mais il est allergique à l’école, ça le rend malade. Il se sait gay depuis tout petit et ça le met mal à l’aise. Ses parents se chiquent la gueule sans arrêt alors ils se séparent et elle, incapable d’élever ce garçon, et sans désir de le faire, elle le file à son psy qui va l’intégrer à ses autres enfants, adoptifs ou non.
Cette maison, c’est un vrai bordel, tout est jeté par terre, entamé sur les canapés, le chien fait ses besoins dans le living, les enfants bouffent les croquettes, n’ont aucune discipline selon la vision du psy qui prétend que chaque être sait ce qui est bien pour lui. Dérangé un premier temps par la crasse qui règne partout, il se fait à cette vie fantasque sans contraintes, pas d’école car le psy lui a indiqué comment se suicider pour de faux donc en être exonéré, on fume, on mange n’importe quoi à n’importe quelle heure. A treize ans, il va faire connaissance avec un fils adoptif du psy de 34 ans, gay aussi, qui va lui montrer par la force ce que sont les rapports gay. Ouch ! Quand il rentre chez sa mère, il la trouve au pieu d’abord avec la femme prude du pasteur puis ensuite avec une grosse black qui s’occupe bien d’elle.
Grosse question : que va-t-il faire de sa vie ? Il aimerait être médecin mais il faut aller à l’école ou alors coiffeur mondialement célèbre grâce à ses produits, comme Max Factor.
Sa vie est complètement farfelue. Est-ce réellement réel ? Le film qui en a été tiré dont j’ai regardé la bande-annonce est tout propret par rapport aux descriptions qu’il nous donne.
En même temps, l’écriture est vivante, cinématographique, très américaine. Drôle donc.
Courir avec des ciseaux d’Augusten Burroughs, 2002 en VO, 2005 en VF aux éditions passage du Marais, traduit par Christine Barbaste. 290 pages, 21€. Et chez 10-18.
Texte © dominique cozette