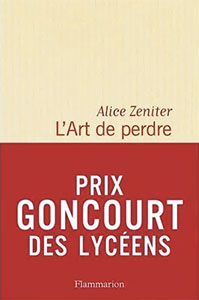
L’art de perdre d’Alice Zeniter fait partie des livres qu’on m’a prêtés pendant cette période sans librairies et à côté duquel je serais passée, ce qui aurait été fort dommage. Curieusement, cet excellent roman est de la même inspiration que celui dont je vous ai parlé la semaine dernière, le Pays des autres, de Laïla Slimani car ici aussi, c’est une jeune femme d’aujourd’hui qui reconstitue le parcours de ses ascendants, grands-parents, parents et parentèle collatérale venus du Maghreb. Le premier avait pour cadre le Maroc, jusqu’en 54, date de son indépendance, et pour celui-ci, c’est l’Algérie et sa guerre d’indépendance, jusqu’à nos jours.
Le grand-père, Ali, est un montagnard kabyle qui cultive ses terres dans un magnifique paysage très sauvage où personne ne passe, loin de la ville. Il renvoie sa première femme parce qu’elle est stérile puis épouse Yema,une jeune fille toute petite, alors qu’il a une stature de géant, qui lui donnera un fils. Pour commencer. Ils auront dix enfants. Mais le premier fils, Hamid, c’est le trésor d’un père musulman, c’est à lui de soutenir la famille plus tard. D’ailleurs, il sera vite de toutes les obligations administratives et plus puisque ses parents sont analphabètes. Ali ne fait pas de politique, du moins comme l’indique l’auteure, il n’a pas les éléments pour comprendre ces choses, mais il a servi dans l’armée française, aussi continue-t-il à entretenir de bonnes relations avec notre pays, au grand dam d’autres membres de la famille qui sont indépendantistes. D’où beaucoup de brouilles, des morts.
Puis vient le moment où ils sont obligés de quitter l’Algérie, en 62. La France va tellement bien s’occuper d’eux qu’ils atterrissent dans le fameux camp de Rivesaltes, un lieu immonde, sale, froid, sans aucune commodité. Hamid a sept ans, il va aller en classe. Cette très mauvaise période assez longue se terminera lorsqu’on les logera dans une HLM en Normandie, où ils ne se sentiront jamais chez eux. Yema fait ses gosses, son ménage et sort peu. Elle ne comprend pas le français. Ali est embauché à l’usine où son emploi n’évoluera jamais contrairement aux Français de souche qui eux montent en grade. Hamid va prendre ne charge toutes les tâches que les voisins ne peuvent et ne savent pas faire, étrangers non intégrés qui ne comprennent rien. Il le fait avec grâce, c’est son rôle d’aîné bien que sa sœur est capable d’en faire autant, mais on ne le lui demande pas car c’est une fille. Ils craignent tellement qu’elle se laisse entraîner à devenir comme les Françaises en pantalon qui fument et sortent. Hamid travaille bien, il ne demande qu’à sortir de ce piège qu’est leur famille fermée sur elle-même. Il fera des études qui lui ouvriront l’esprit, d’autant qu’il devient ami avec deux étudiants révolutionnaires, intellectuels de gauche.
Puis il rencontre Clarisse et tous deux vont vivre leur amour malgré leurs hésitations du début, aucun n’osant avouer cette relation « contre nature » à ses parents.
Clarisse, fille charmante, apaisante, facile à vivre, ne réussira jamais à débloquer l’intimité d’Hamid sur ce qui s’est passé aussi bien pour son père que pour lui et qui semble leur pourrir la tête. Parfois, il est question d’emmener toute la famille là-bas, revoir la maison, les monts d’oliviers, les frères et cousins restés au pays, mais à cause d’attentats ou autres événements tragiques, ils s’y refusent.
Naïma, la narratrice, la seule enfant du couple Clarisse-Hamid, éprouve beaucoup de tendresse pour sa petite grand-mère algérienne, désormais veuve, mais vu qu’aucune ne parle la langue de l’autre (Hamid s’est bien gardé de parler arabe à sa fille), Naïma ne connaîtra jamais non plus cette histoire familiale, ses malheurs, la tristesse d’avoir perdu leur paradis.
Pourtant, elle sera poussée à aller en Algérie pour un travail artistique. Là, elle est accueillie dans un groupe d’intellectuels et autres artistes qui vivent peu ou prou comme elle. Puis se rendra, avec crainte, et sans s’annoncer, dans la montagne de ses aïeux, région contrôlée dorénavant par les barbus réacs. Elle y découvrira la chaleureuse ambiance de ces gens qui vivent de façon précaire mais ne sentira pas la fibre censée vibrer quand on retrouve ses racines.
Ce livre est passionnant dans l’optique socio-ethnologique. Il est raconté de façon tellement vivante qu’on voit les scènes en les lisant. La patriarchie, l’écrasement des femmes, les événements politiques, puis l’arrachement d’une terre qu’on révère, qu’on a bâtie, irriguée de son sang. Et la dure réalité d’une transplantation dans un pays raciste où jamais on ne trouve sa place, jusqu’à la génération présente où beaucoup ne réussissent pas à pardonner à ceux d’avant, où les histoires du passé, tenaces, impactent encore la construction de leur être.
L’art de perdre d’Alice Zeniter, 2017 aux éditions Flammarion, 510 pages. 2019 aux éditions J’ai lu.
Prix littéraire du Monde 2017, Prix des libraires de Nancy 2017, Prix Goncourt des lycéens 2017
Texte © dominique cozette