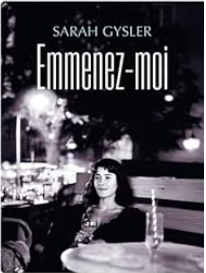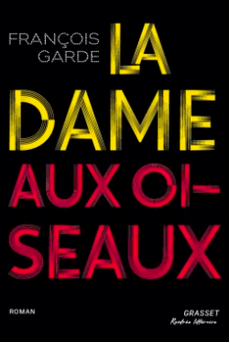Rentrée littéraire. Ce livre, Devenir écrivain d’Alexandre Lacroix, n’est pas un tuto pour ceux que la plume gratouille, c’est son histoire et comment il y est parvenu. C’est en l’entendant à France Inter dans l’émission de Charles Pépin, Sous le soleil de Platon, que j’ai eu envie de le lire. Chance, la personne par qui j’ai tous ces livres de la rentrée en avant première, l’avait reçu.
Notre héros, Alexandre puisque c’est lui, a toujours en envie de faire ce métier, il se serait damné pour ça. Il n’a pas de très grandes ambitions à part ça et pourtant, il est très doué pour les études. Néanmoins, il est très souvent seul, jamais sans ses lectures du genre costaudes et intello, ne fraye pas beaucoup avec les dames, ce n’est pas non plus son sport favori.
En fait il trimballe depuis ses onze ans, un paquet toxique, la mort de son père. Ou plutôt la pendaison de son père qu’il a découverte en rentrant de l’école. Vous parlez d’un souvenir. Mais avant de se décider à écrire sur ce douloureux problème, il procrastine, intelligemment, en absorbant le maximum de bouquins. On le trouve au quartier latin, dans quelques bistrots, parfois mal accompagné, mais aussi flanqué d’une maîtresse régulière avec qui ils ne font que l’amour, rien d’autre.
Quand il se décide à raconter et à montrer la première mouture de son texte qui commence par la pendaison, il se prend un gros vent. Puis il intéresse un jeune éditeur chez Grasset. Puis il aura son contrat mais le bouquin ne peut sortir que dans un an et demi. Il continuera ses études mollement, sa relation avec sa nouvelle fiancée, ses beuveries avec des potes de rencontre dans le bar d’en bas. Son bouquin va être de nouveau refusé malgré un travail de trois ans puis… surprise.
En fait c’est une histoire vraie, son livre qui s’appelle Premières volontés existe comme son tout premier livre et les anecdotes qui y sont narrées sont assez croustillantes. Moi qui ai été chez Calmann et Grasset, je peux confirmer que les personnages cités par leur vrai nom, existent bel et bien.
Et puis, bien d’autres ouvrages ont suivi, romans, essais, réflexions. Celui-ci sort le 21 août.
Devenir écrivain par Alexandre Lacroix, 2025 aux éditions Allary. 370 pages.
Texte © dominique cozette