
La danseuse de Patrick Modiano. Je ne sais pas quoi penser de ce livre…
Le blog de Dominique Cozette

La danseuse de Patrick Modiano. Je ne sais pas quoi penser de ce livre…

L’Ami de Sigrid Nunez a reçu le National Book Award en 2018, c’est dire que c’est un très bon livre. Mais pas nécessairement d’accès facile, tout comme le précédent de cette autrice dont j’ai fait un article il y a peu. Sigrid Nunez est une femme qui digresse énormément, elle est extrêmement cultivée, on a l’impression que la littérature, américaine comme européenne n’a plus de secret. On peut aimer la suivre dans le dédale de ses pensées. On peut ne pas.
Ici, l’ami auquel elle s’adresse (elle lui dit tu ) est un homme qu’elle connaît depuis longtemps, qui l’a formée pour ainsi dire et qu’elle n’a jamais cessé de fréquenter malgré ses trois mariages. C’est sa troisième épouse qui contacte la narratrice pour lui confier le chien que l’ami, mort par suicide sans un mot ou une lettre, a laissé. Cette femme ne peut pas s’en occuper, alors la narratrice va recueillir cet énorme danois, plus tout jeune et grand comme un poney, dans son minuscule appartement new-yorkais où les chiens sont interdits. Au départ, il est passif, voire neutre, elle pense qu’il est affligé de ne plus voir non maître. Et il prend possession du lit, elle n’ose pas l’en déloger. Sinon il se promène dans la rue gentiment, sans aucun problème, sous l’admiration des badauds croisés.
Ce chien, qu’elle appelle Apollon, va devenir sa thérapie, il va l’aider à surmonter sa peine et même si certains de ses amis ne veulent plus la voir à cause de lui, elle continue à creuser le sillon de l’empathie avec cet animal. Peu à peu, ils vont finir par se comprendre, enfin plus ou moins pour ce qu’on peut savoir sur une telle cohabitation. Très beau passage où elle se rend compte qu’il adore l’écouter lorsqu’elle lit ses textes à haute voix. Et qu’il les réclame.
Ce livre explore de nombreuses questions, notamment sur les relations humains-animaux, leur compréhension réciproque, avec beaucoup d’exemples piochés dans la littérature et des anecdotes rapportées de loin. Questionnement aussi sur le suicide, sur l’écriture (son ami était comme elle prof de lettres et écrivain). L’amitié va aussi être un de ses sujets de prédilection, toujours à la recherche de comparaisons écrites par d’autres. Ce livre un peu complexe n’a rien à voir avec Mon chien stupide, par ailleurs très chouette bouquin de John Fante.
Vers la fin du livre, remarquons que le « tu » qu’elle adressait à son ami est dorénavant adressé au chien lui-même, glissement de l’amitié sûrement.
L’ami de Sigrid Nunez. ( The Friend 2018). Au Livre de Poche, traduit par Mathilde Bach. 236 pages, 7,90 €
Texte © dominique cozette

Le couteau est le premier livre de Salman Rushdie que je lis. Le sous-titre est à l’intérieur du livre : Réflexions suite à une tentative d’assassinat. C’est cela qui m’a tentée. Les réflexions. Le livre en est truffé, il se pose d’infinies questions, notre survivant mais pas forcément sur la religion. Il revient sur des épisodes passés, il nous présente sa nouvelle femme (j’ai regardé sur Google : une bombe ! Comme d’ailleurs la première) qu’il venait juste d’épouser. Il nous renseigne très vaguement sur l’assassin raté, un jeune type qui n’a lu que trois pages des Versets Sataniques, donc pas du tout au courant de la raison pour laquelle Rushdie avait cette fatwa sur la tête.
Et puis il nous décrit avec une précision chirurgicale, c’est le cas de le dire, les interventions, les souffrances, les tortures que son corps a subies, le travail des soignants, les ruses pour échapper ensuite aux paparazzi. Les énormes inconvénients d’être loin de chez lui, blessé, borgne surtout. L’histoire de sa main qui a bien morflé. Il n’oublie pas les morts pour la liberté d’expression dont les victimes de Charlie sur lesquelles il revient souvent.
Et puis il évoque aussi le vie insouciante qu’il avait fini par mener, pensant la menace éteinte, depuis tout ce temps. Comble de l’ironie : cette attaque s’est produite alors qu’il se trouvait dans un endroit extrêmement protégé, créé pour les artistes menacés justement. Comme quoi.
Tout le livre est assez palpitant même si l’on sait que Rushdie a échappé au pire. Le seul long passage assez ennuyeux : le chapitre où il imagine un dialogue entre lui et son agresseur emprisonné. Comme il ne veut pas le rencontrer en vrai et que d’ailleurs celui-ci ne parle pas, il créé cette rencontre qui manque énormément d’intérêt. Evidemment qu’il peut facilement lui claquer le beignet à ce pauvre mec, pas la peine d’en rajouter. Bon, je pense que ça lui a fait du bien de l’affronter, même pour de faux.
Le Couteau se lit comme une puissante réflexion porteuse d’espoir sur la vie, parfois intime, où il déroule une ode à l’amour, à la création artistique comme espace de liberté absolue.
Le couteau de Salman Rushdie, 2024 aux Editions Gallimard. Traduit par Gérard Meudal. 270 pages, 23 €.
Texte © dominique cozette

Petite référence à la Souche pour ce nouveau livre d’Edouard Louis que sa maman a peut-être surnommé Doudou dans l’enfance. En tout cas, elle l’appelle un soir au secours car elle n’en peut plus de l’homme avec qui elle habite. Le livre s’appelle Monique s’évade et c’est bien de cela qu’il va s’agir. L’écrivain est alors en résidence en Grèce quand survient ce coup de fil inquiétant, sa mère est en danger car le mec est violent quand il est bourré et il l’est tout le temps.
Pourtant, tout avait bien commencé. Monique, la mère d’Edouard Louis donc, avait viré son mari, le père d’icelui, assez brutalement puis était venue vivre à Paris, histoire racontée par le fils, tout allait bien, elle avait même rencontré Catherine Deneuve, elle qui sortait d’un trou à rat. Hélas, ce nouveau compagnon peu à peu devient un tel cauchemar et une telle menace qu’il faut agir vite. Alors le fils appelle ses amis à Paris et ce sont eux qui vont aider la dame, l’accueillir, l’installer dans l’appartement de son fils, lui acheter des provisions et lui prêter de l’argent. Puis Edouard Louis va téléguider, par téléphone, la suite des événements, c’est difficile et stressant. Il faut aussi qu’il demande de l’aide à sa sœur avec qui est fâché depuis dix ans, mais les choses se font…
Plein de petits détails sur la vie de la maman nous sont narrés, ses goûts, ses teintures, ses désirs. Et puis surtout, et ça n’est pas rien, il la décrit quand elle devient l’héroïne de sa propre histoire (celle où elle se métamorphose) sur une scène de théâtre et qu’elle monte sur scène où elle est acclamée. Quelle revanche !
L’histoire n’est pas banale, certes, l’écrivain se montre sous le jour du bon fils, revient sur toutes les critiques qu’il avait émises sur sa mère, sa violence notamment dans Eddie Bellegueule, explique pourquoi elle ne pouvait qu’être ainsi face à la violence du mari, de leur pauvreté et de leur croupissement dans leur trou du nord où aucun espoir d’amélioration ne pouvait s’envisager.
C’est un court récit un peu paresseux (je trouve), pas très creusé car apparemment l’écrivain était sur un autre projet (son frère) mais malgré tout suffisamment intéressant « sociologiquement » pour que les médias en parlent avec enthousiasme. Les problèmes de transfuges de classe, ils aiment bien, les médias actuellement. Mais c’est bien quand même, si, si…
Monique s’évade d’Edouard Louis. 2024 aux éditions du Seuil. 170 pages, 18 €
texte © dominique cozette

Dans ce livre, Journal d’un vide, madame Shibata est une trentenaire employée dans une entreprise de contrôle de tubes en carton. C’est d’autant moins passionnant comme job qu’étant la seule femme de toute l’équipe, c’est à elle qu’incombent les tâches dites féminines dans les sociétés machos comme le Japon : rangement des salles de réunion, café à faire, à servir, à débarrasser etc. Un jour, elle en a marre, la vision et l’odeur de mégots dans un fond de café l’écœurent, alors, pour couper court à cette corvée, elle déclare qu’elle est enceinte et que cela lui donne des nausées.
Elle n’est pas enceinte, elle vit seule, n’a pas de liaison. Elle travaille face à un employé comme elle qui ne cesse de l’observer, de la scruter.
Elle tient bon. Du coup, elle accède aux privilèges réservés à son état : quitter tôt, être respectée, ne plus accepter certaines tâches. Elle découvre les heures de pointe de l’après-midi mais aussi le plaisir de trouver encore des produits frais au super market et d’avoir le temps de cuisiner, et même de prendre des cours de gym prénatale.
Il lui faut adapter son physique au mensonge. Ça commence par des tissus enroulés sur son ventre puis, comme elle mange beaucoup et qu’elle grossit, elle s’en passe. C’est un peu là où le bât blesse, ainsi que la séance d’échographie. Tout ça manque un peu d’explications crédibles. La fin est un peu schématique aussi. Certes, ce n’est pas un chef d’œuvre mais l’intérêt de cette fable est de nous faire découvrir le monde du travail au Japon où la femme a encore fort à faire pour une certaine égalité…
Journal d’un vide d’Emi Yagi, 2020. Traduit par Mathilde Tamae-Bouhon. Aux éditions de poche 10/18. 212 pages, 8,60 €.
Texte © dominique cozette

Drôle de titre pour ce livre de Sigrid Nunez, qui est extrait de la chanson Restless Farewell de Bob Dylan, morceau fétiche des deux héroïnes. Rien à voir avec le titre anglais The last of her kind (la dernière de son espèce). Et nos yeux doivent accueillir l’aurore est, outre une histoire des mœurs américaines des années 70 aux années 90, celle de deux amies qui se sont rencontrées sur le campus d’une petite université. La narratrice, George (pour Georgette) a fui son milieu familial moche, violent, ennuyeux, et sa copine de chambre, Ann, a fait de même pour des raisons opposées : elle ne veut plus de la vie de luxe de ses parents, leur héritage culturel foireux et cette fortune créée sans aucun doute sur le dos de l’esclavage. Totalement radicalisée, elle souhaite même avoir une copine pauvre et pourquoi pas noire ?
La suite, une fois n’est pas coutume, je la vole à Babelio car j’ai la flemme d’éplucher la densité de ce roman :
« Au travers de la relation d’amitié chaotique entre Georgette et Ann, c’est l’histoire récente des USA qui nous est racontée : du vent de liberté apporté par les années 60 au puritanisme des années 90 en passant par Woodstock, les hippies, les mouvements pour les droits civiques, les Black Panthers et le Weatherman, l’apparition du sida. Georgette, narratrice, nous montre le contraste entre une époque de libertés et d’expériences en tous genres (sexe, drogues), de luttes et de convictions, et celle qui, à peine deux ou trois décennies plus tard, apparaît tout aussi précaire mais beaucoup plus dure, étriquée, dangereuse. Avec cette question paradoxale : pourquoi, comment est-on passé de l’une à l’autre ? »
« Voici quelques uns des thèmes intéressants dans ce roman : féminisme, militantisme, hippie, anti-racisme, drogues, inégalités, « sex, drug and rock’n roll ». D’autant que ces sujets sont traités de façon originale et décalée. Le point de vue d’Ann, la jeune fille de bonne famille, riche, trop empathique, se confronte à celui de Georgette, issue d’un milieu très défavorisé qui cherche à s’élever socialement, et enfin à celui de Solange, la fugueuse junkie bipolaire qui a décidé de « vivre à fond »… le tout saupoudré de nombreuses références, souvent intelligentes, toujours documentées. Avec parfois des longueurs (particulièrement un épisode de trip entre sœurs ou le récit carcéral de fin d’ouvrage). »
Mais malgré tout, il y a beaucoup à piocher dans ce livre plein d’idées, de références, d’anecdotes et même d’un résumé de la vie de Simone Weil, la philosophe.
Et nos yeux doivent accueillir l’aurore de Sigrid Nunez (2005 aux USA, 2014 en France). Traduit par Sylvie Schneitter. Au Livre de Poche. 540 pages, 9,70 €
© partiel dominique cozette
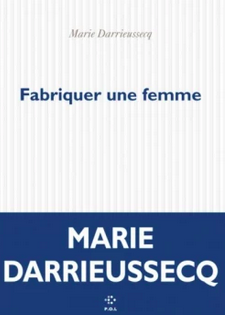
C’est le dernier livre de Marie Darrieussecq, une autrice qui ne me passionne pas toujours. Dans Fabriquer une femme, elle reprend les deux filles qu’elle nous avait présentées dans d’autres romans (que je n’ai pas lus), Rose et Solange, habitant un bled nommé Clèves où elle a déjà situé ses histoires. Ces deux ados, les meilleures amies du monde, habitant l’une en face de l’autre, commencent à diverger à l’âge de quinze ans. Car à quinze ans Solange accouche très très douloureusement d’un môme dont elle ne voudra pas, dont elle ne sait pas trop qui est le père. C’est la cata. Rose, elle, continue son petit bonhomme de chemin, sage, studieuse et commence à se dévergonder gentiment lorsqu’elle va étudier « en ville ». Elle découvre l’alcool, les fêtes, le sexe.
Ce qui est marrant dans ce livre, c’est qu’il nous est raconté par les deux bouts de la lorgnette, d’après Rose, puis d’après Solange. Ce ne sont pas les mêmes sons de cloche, bien sûr. L’une fait ses études, retrouve ses parents le week-end, une famille solide, aide ses voisins etc. Le garçon dont elle est tombée amoureuse très jeune deviendra son amoureux officiel et aura le droit de passer ses après-midi dans la chambre de la jeune fille, porte fermée. Tous deux sont à la découverte de leurs corps et de leurs émois, inexpérimentés, hélas pour leurs premières expériences fatalement décevantes. Mais elle l’aime, c’est réciproque et elle sait qu’il sera son mari et le père de ses enfants.
Solange quant à elle vit mal sa vie de famille qui n’est pas une bonne famille. Elle abandonne le bébé à sa mère qui l’a prénommé Thierry, aïe, en souvenir d’un bébé qui est mort avant Solange. Pour Solange, la vie, c’est le théâtre, le cinéma, la télé, séduire, vivre à la marge. Ce trajet l’emmènera jusqu’à Hollywood (via Londres) où elle peut enfin briller. Enfin pas toujours. Elle gagne super bien sa vie mais est-elle heureuse ?
Elles se reverront plus tard, adultes, dans la grande métropole californienne, lors d’une première où toute la famille de Rose est invitée ainsi que les parents de Solange et son fils, grand ado handicapé mental. Car le film doit consacrer Solange. Mais mais mais…
Ce livre est distrayant, Marie manie la plume avec talent mais je trouve que tout ceci manque de sincérité. Je veux dire que c’est un peu clinquant, on cite des noms de lieux, de people, on peut même coucher avec… j’ai eu l’impression que MD nous faisait faire une visite guidée dans années 80-90. Avec Internet, ces intrusions dans le passé sont devenues courantes, précises et faciles. A part ça, comme je l’ai dit, ça se lit bien, que demander de plus ?
Fabriquer une femme de Darrieussecq, 2024 chez P.O.L. 334 pages, 21 €
Texte © dominique cozette

Ce livre de rage et d’amour s’intitule L’Invincible été de Liliana et a été écrit par la sœur de Liliana, Cristina Reverza Garza, trente ans après son l’assassinat par son « petit ami », harceleur qu’elle avait décidé de quitter. Ça se passait au Mexique, l’un des pays les plus violents pour les femmes, où les féminicides ne se comptent plus.
Trente ans après donc, Cristina tente de faire rouvrir le procès et retrouver l’assassin qui a pris la fuite après le meurtre par étouffement. Certes, il n’est pas facile de retrouver tous les proches de la jeune femme, morte à vingt ans en 1990, étudiante brillante en architecture, grande, sportive, libre, curieuse, drôle, appréciée de tous et qui avait pour projet de continuer son cursus à Londres l’année suivante. Cristina s’est acharnée à rencontrer toutes ces personnes et surtout à décrypter dans la myriade de notes, dessins, mots, archives de toutes sortes jamais datées, l’historique de la jeune vie de Liliana. On se rend compte de par son vocabulaire et ses poésies qu’elle cogitait intelligemment, se posant de bonnes questions sur la vie et les relations humaines. Et surtout qu’elle ne se voyait pas s’installer avec le jeune hommes qu’elle fuyait souvent mais avec qui elle se réconciliait souvent aussi. Personne de son entourage, ni même sa sœur qui faisait ses études aux Etats-Unis n’était au courant de la relation toxique du gars, de sa brutalité et de sa violence, elle gardait ça pour elle, elle ne s’est jamais plainte. Même si parfois, cela rejaillissait sur son humeur ou sa peau.
Mais c’est bien lui qui s’est introduit dans son bout d’appartement en coloc cette nuit-là, très discrètement, et qui a étouffé sous un oreiller celle dont il refusait la rupture. Chanson connue, pourtant.
Le plus dur, pour les parents, c’est qu’ils étaient partis plusieurs mois en voyage pour clore agréablement leur vie de labeur par un long périple aux quatre coins de l’Europe, leur superbe récompense. Ils étaient injoignables… Les obsèques ont été célébrées sans eux, ils ont appris cette immense tragédie à leur retour au village.
C’est un livre plein d’amour pour une jeune femme qui promettait, comme on dit, dont l’avenir semblait radieux. Et plein de rage aussi contre non seulement l’assassin mais aussi le système patriarcal dans son ensemble qui perpétue les crimes fats aux femmes.
L’Invincible été de Liliana de Cristina Reverza Garza, traduit par Lise Belperron. 2024 aux éditions Globe. 392 pages, 23 €.
texte © dominique cozette

Jeannette McCurdy raconte son histoire. Génial, ma mère est morte est ce qui lui est arrivé depuis qu’elle est petite fille et que sa mère a décidé d’en faire une vedette du petit écran. Leur vie, alors, est assez pourrie. Le père est d’un pénible épouvantable, les frères oui bof et la maison est carrément une déchetterie. Tout s’y empile, s’y entasse, les différentes pièces sont emplies jusqu’à la garde de saletés à tel point que les chambres d’enfants ne peuvent plus servir. Alors chaque soir, ils déplient des espèces de matelas, des futons peut-être, sur le parquet du « salon » (du salaud, oui). Horreur. Les factures ne sont jamais honorées, c’est l’enfer.
C’est là que la mère a une idée lumineuse. Puisque sa fille Jeannette, qu’elle adore et qui l’adore, est mignonne, pourquoi ne pas en faire une mini-vedette des séries enfantines ? Alors, la machine se met en route. De casting en casting (lever à cinq heure du matin) de cours de maintien en conseils de comportement pour se faire aimer des agents, la petite affronte le monde terrible du show-business sans aucun plaisir. Elle déteste. Mais elle aime tellement sa maman qu’elle lui obéira aveuglément pendant de nombreuses années (sa mère continuera à la doucher jusqu’à l’âge de seize ans. Pour mieux la contrôler, bien sûr).
Et ça marche, même si le vedettariat est un peu long à démarrer. Grâce à la petite qui commence à faire son trou, l’argent rentre chaque mois, c’est formidable.
Mais aïe, à onze ans, des petits seins pointent. Ah, non, pas de ça Jeannette ! Tu es une enfant vedette, tu dois rester une enfant. Le fait qu’elle soit un petit modèle arrange déjà bien les choses, mais il faut empêcher les hormones d’entreprendre leur travail de sape. Alors hop ! Régime draconien. Et quand je dis régime, je dis famine. L’anorexie s’annonce sans que la fillette s’en émeuve. Elle est contente de déguster sa feuille de salade puisque c’est sa mère qui le lui demande. Jusqu’au jour où elle découvrira que vomir, c’est aussi une bonne solution. Donc boulimie.
En même temps, sa mère souffre d’un cancer du sein, il ne s’agit pas de la mécontenter. L’amour de la gamine déborde de partout, pauvre gamine. Mais la mère ne meurt pas encore, elle s’en sort, s’y remet avec rage, elle tutoie tous les importants, les paparazzi sont ses potes, elle fait le buzz pour qu’on parle de sa fille et la gloire arrive suivie de toutes ses odeurs de rance.
C’est un livre extrêmement bien conçu car évidemment, on prend parti pour la môme qui raconte bien et qui se moque d’elle-même. C’est frais, désespérant et très drôle. Les courts chapitres traitent chacun d’un thème important au royaume des mini-stars et des bêtes d’Hollywood, on comprend comment les choses se trament, on y voit la douleur, les sacrifices, les désillusions et bien souvent les addictions avec tous les produits auxquels les victimes s’accrochent pour se consoler d’être autant exploitées. La déglingue, l’alcool, la dope, le sexe sont entrés dans la vie de la jeune star, qui dépérit de mal-être, de désespoir, de honte et de dégout d’elle-même, merci maman. Qui finira par mourir. Mais pour autant restera le grand amour de sa fille, même si elle apprend, par des cures, qu’elle a fait preuve d’une profonde maltraitance à l’égard de sa fille.
Ce n’est pas un livre glauque, la jeune femme a su faire de son histoire le fond de commerce hilarant de ses spectacles qui sont très appréciés.
Génial, ma mère est morte de Jeannette McCurdy (I’m glad my mum died, 2022), traduit par Corinne Daniello, livre dédié à ses trois frères cités. Edition JC Lattès, 2024. 396 pages, 22,50€.
Texte © dominique cozette

Ce n’est pas le livre de la décennie ni le meilleur des Moriarty, cette fameuse écrivaine australienne qui dissèque les liens entre humains principalement ceux liés aux relations amoureuses, mais Amours et autres obsessions m’a aidé à remplir quelques nuits blanchâtres et c’est déjà pas mal. C’est longuet à souhait, plein de digressions et d’explications, mais c’est aussi ce qui fait le charme des livres un peu épais qu’on a plaisir à retrouver.
L’histoire est assez simple : Patrick Scott vit avec son petit garçon de huit ans depuis la mort de sa femme chérie, victime d’un cancer fulgurant quand le petit avait trois ans. Ce dernier ne se souvient pas d’elle, bien sûr. Au début du livre, on se trouve au cabinet d’Ellen, hypnothérapeute, trentenaire, vivant seule et rêvant de l’amour qui dure. Sa mère l’a fabriquée avec un amant éphémère qui cochait toutes les bonnes cases du géniteur idéal, avant de vivre avec deux copines, les marraines d’Ellen. Elle rencontre Patrick sur un réseau, ce n’est pas le coup de foudre immédiat d’autant plus qu’il n’est pas très à l’aise car il lui apprend qu’il est harcelé par son ex (la seule à dire « je » dans le livre) qui le suit partout, lui envoie des textos, des fleurs etc. Cette femme a servi d’objet transitionnel à Patrick et s’est formidablement bien occupée de son gamin, lui en étant incapable. Pour le gamin, c’était sa maman. Ça se passait super bien, la famille de l’épouse décédée l’avait même adoptée. Jusqu’au jour où Patrick l’a jetée sans état d’âme, sans réelle explication, sans lui donner le temps de s’organiser et de dire au revoir au gosse. Et sans l’autoriser à le revoir.
C’est pourquoi elle continuera à lui faire payer cette injuste rupture, elle n’a rien fait de mal, elle a bien accepté le fait qu’il aimera toujours sa femme morte plus qu’elle… Donc pourquoi ? Et ce n’est même pas parce qu’il a rencontré Ellen.
D’ailleurs, Ellen connaît cette femme sans savoir qu’il s’agit d’elle. Ellen acceptera elle aussi les conditions de ce nouvel et bel amoureux : l’amour qu’il aura toujours pour sa femme, le gamin à élever et toutes sortes de contingences auxquelles elle devra faire face et s’accoutumer au fil du temps…
Je ne vous en dis pas plus, il y a quand même pas mal de suspense que je divulgâcherai pas.
Amours et autres obsessions par Liane Moriarty, (The hypnotist’s love story, 2011), traduit par Béatrice Taupeau, au Livre de Poche. 576 pages, 9,70€
Texte © dominique cozette