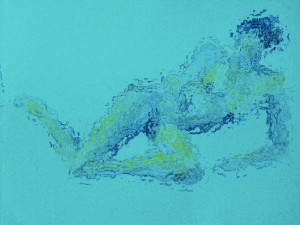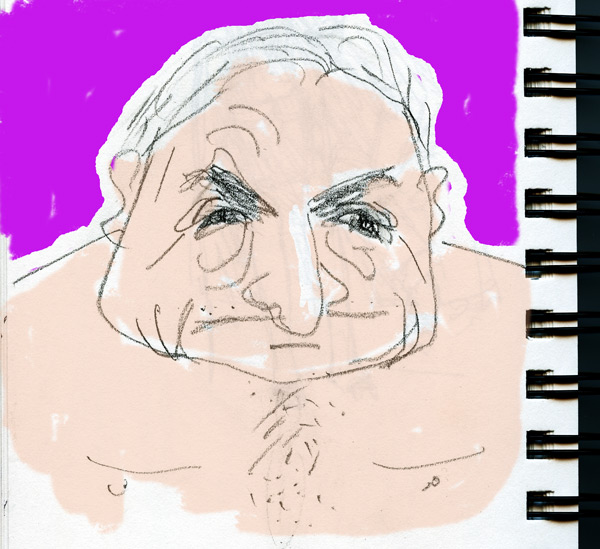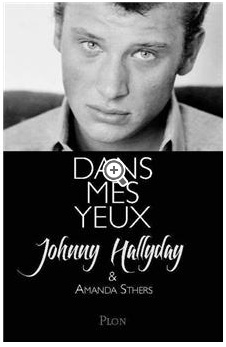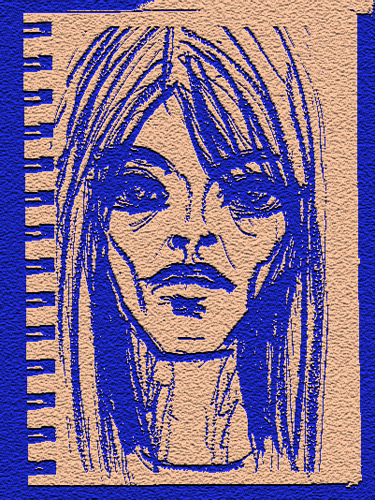Oui, vous avez bien vu, sur cette photo réalisée par votre serviteuse durant l’hiver 64, deux des Beatles — et bizarrement les survivants — rue Bayard ou François 1er je ne sais plus, la rue de RTL où se déroulait l’oubliée émission Balzac 10 10 ou Balzac dix deux fois, de Jacques Garnier, Philippe Adler avec souvent la collaboration de Francis Weber. C’était pour concurrencer Salut les Copains, elle avait lieu à la même heure mais elle a fait pschitt assez rapidement. Sur Google, il n’y a presque rien. C’est en faisant un peu de ménage dans mes vieilles affaires que je suis retombée dessus. Je l’avais idéalisée, je l’imaginais plus… plus réussie.
Donc moi qui traînais à SLC très souvent, je n’ai pas résisté à l’appel de Bal 10 10, je m’y suis conviée avec culot et y ai été reçue avec gentillesse. Et un jour, ils m’ont prévenue de la venue des Beatles qui faisaient l’Olympia en vedette américaine de La Plus Belle pour Aller Danser et Trini Si j’avais un marteau Lopez (j’y était, forcément !). Les quatre garçons dans le vent ne suscitaient pas encore la folie des quelques mois plus tard, mais quand même, ils créaient l’événement. Tous leurs 45 tours se vendaient comme des petits pains, moi-même je les avais connus avant tout le monde puisque ma correspondante anglaise m’avait envoyé Love me do, leur premier 45 t. simple.
J’ai ainsi passé toute l’émission sur les grands banquettes en velours entourée de ces quatre phénomènes aux cheveux longs (!) que je ne comprenais pas vraiment. J’avais pour pratique de ne jamais demander d’autographe (j’ai fait exception pour Gene Vincent), je suis restée coite, mais j’avais apporté mon petit appareil. Et ce n’est que dehors, parmi les fans qui se pressaient dans le froid, que j’ai pu capter cette superbe photo où l’on devine Paul et Ringo. Sir Richard Starkey et sir Paul Mc Cartney. Une belle gifle à Jean-Marie Périer, non ?
En cherchant un peu plus d’infos, je découvre que les Fab Four ont donné leur tout premier concert juste avant l’Olympia, à Versailles, sorte de test qui se faisait régulièrement. (Voir lien ici)
Et une photo de cette chouette époque où on descendait direct de l’avion parmi les gens qui venaient nous accueillir. Notez que parmi cette petite foule de personnes d’âge indéterminé parfois tonsurées, ça manque de jeunes filles hystériques en larmes. Ça viendra vite.