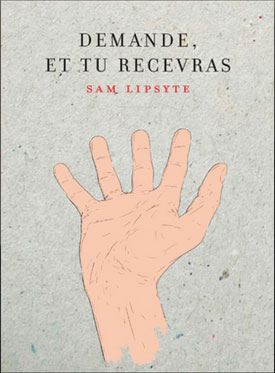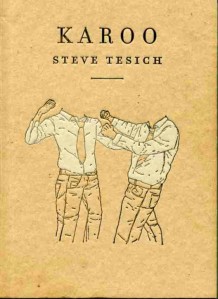La mélancolie de celui qui vise juste est un roman très original de Lewis Nordan, né en 1939 dans le Mississipi et mort en 2012 dans l’Ohio. Il est édité par Monsieur Toussaint l’Ouverture, une maison d’édition qui soigne ses publications comme nul autre éditeur, avec des couvertures magnifiques et des commentaires originaux. Celle-ci est toilée. Je reçois ses newsletters et ça m’a donné envie de ce livre. Et comme ça se passe dans les bayous, j’ai aussi pensé à l’ambiance du film de Tavernier Dans la brume électrique, inspiré du roman Dans la brume électrique avec les morts confédérés, super bouquin de James Lee Burke. C’est juste pour l’ambiance.
Dans La mélancolie de celui qui vise juste, le héros principal se nomme Hydro, comme hydrocéphale car le pauvre, il a une grosse tête mal faite. Mais c’est un bon petit, chéri par son père, pêcheur dans le bayou, qui lui prépare chaque jour des tartes aux pêches qu’il dégustera dans la boutique-pompe à essence qu’il garde, c’est son job, en compagnie d’un petit gars à qui il refile des piles de BD qu’il lit dans l’arrière boutique.
Un jour, deux punks gothiques braquent la boutique. Mal leur en prend car ils vont se retrouver avec une balle dans la tête. Est-ce Morgan, l’as de la gâchette qui a joué à Guillaume Tell l’heure d’avant ? Le petit a tout vu, il a même vu pire. Mais le dira t-il ? Dans ce bled qui s’appelle Attrape-Flèche, au sein d’une végétation luxuriante dans laquelle s’ébattent un tas de bêtes exotiques — il y a même des dauphins qui dansent dans le bayou — défilent des personnages tous plus pittoresques les uns que les autres : le docteur obèse, père du gamin qui ne lui parle jamais, sa jolie femme complètement alcoolique qui s’envoie en l’air avec Morgan, le thanatopracteur alias le Prince des Ténèbres fondu de théâtre, le shériff qui ne ferme jamais la porte de sa prison. Ou les deux gosses du médecin qui partent sous un déluge en pleine nuit sauver des canaris sauvages de la noyade (très joli passage).
C’est une sorte de blues aux accents poétiques que nous déroule l’auteur avec ses portraits fins, inattendus et drôlatiques. Hydro, au cœur du récit, nous touche infiniment, toujours à la recherche de sa mère perdue, jamais une mauvaise pensée mais parfois des gestes désespérés.
Un roman original, attachant, qui nous emmène dans un petit paradis moite, pas forcément rose, où la sueur coule souvent, et les larmes parfois.
La mélancolie de celui qui vise juste de Lewis Nordan 1995 sous le titre The Sharpshooter blues. Edité en 2021 chez Monsieur Toussaint l’Ouverture, traduit par Marie-Odile Fortier Masek. 288 pages, 19 €.
Texte © dominique cozette